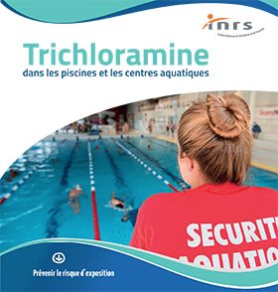Travail & Sécurité. Pourquoi trouve-t-on des chloramines dans l’air des piscines et quels sont les risques pour les personnes exposées ?
Fabien Gérardin. Les bassins sportifs ou ludiques doivent conserver des propriétés bactéricides car, indépendamment du risque de noyade, le risque bactériologique est majeur pour la santé des usagers. L’agent bactéricide le plus couramment utilisé est le chlore, c’est le plus simple d’utilisation et le moins cher. Malheureusement, il pose un problème à travers sa très réactivité non seulement au contact des bactéries mais aussi au contact de toutes les matières biologiques d’origine humaine apportées dans le bassin qui contiennent de l’azote comme la sueur, les peaux mortes, l’urine… C’est cette réaction du chlore et de l’azote qui va produire des sous-produits de désinfection dont les chloramines. Parmi celles-ci, il y a la trichloramine, qui est très volatile et peut provoquer des irritations des yeux et des voies respiratoires. Si certains symptômes cessent lorsqu’il n’y a plus d’exposition, en cas de contact prolongé, comme c’est le cas pour les maîtres-nageurs, personnels des piscines, agents de maintenance ou nageurs professionnels, de l’asthme peut apparaître. L’exposition aux chloramines est, depuis de nombreuses années, inscrite au tableau n°66 des maladies professionnelles.
Comment peut-on diminuer l’exposition aux chloramines ?
F. G. La première mesure est d’éviter au maximum leur formation. Il existe plusieurs possibilités qui peuvent se combiner. Tout d’abord, il y a la question de la substitution du chlore. Des technologies de traitement de l’eau à l’ozone existent, toutefois, leur efficacité est limitée parce que ce traitement désinfecte l’eau mais ne lui accorde pas de propriété désinfectante, comme avec le chlore. Donc, même une eau traitée à l’ozone doit comporter du chlore, mais en moindre quantité, ce qui est déjà une bonne chose. Diminuer la concentration en chlore est en effet un levier pour éviter la formation de chloramines. Mais attention, ce niveau ne doit pas être trop abaissé afin que la qualité de l’eau reste dans les normes fixées par les agences régionales de santé (ARS). Un autre moyen de prévention est de limiter l’apport de matières polluantes par les baigneurs avec un passage systématique aux douches avant l’accès aux bassins et l’obligation du port du bonnet de bain. Il peut être aussi bon d’agir sur la fréquentation des bassins : ainsi, lorsqu’une piscine reçoit des scolaires, mieux vaut accueillir chaque classe sur un créneau horaire différent que toutes en même temps.
Existe-t-il d’autres solutions, techniques ou organisationnelles ?
F. G. Oui, notamment pour capter la chloramine ou pour éviter sa dispersion. Ainsi, depuis l’évolution réglementaire de 2021, toutes les nouvelles piscines construites, ou rénovées, doivent être équipées de bacs tampons avec un système de strippage. En fonction de la fréquentation du bassin, les bacs tampons récupèrent le trop plein d’eau. À ce moment-là, le système de strippage permet d’extraire la trichloramine de l’eau réintroduite dans le bassin. Autre point important, il est essentiel d’assurer une bonne ventilation des bâtiments. Mais il est aussi possible d’agir pour diminuer la diffusion de la trichloramine dans l’air en évitant la mise en service en continu des jeux d’eau comme les cascades ou jets. Enfin, il convient de baisser la température de l’eau, avec un compromis pour le confort des usagers à 26 °C pour les bassins sportifs.
Les enjeux environnementaux liés à l’eau, et à la baisse de sa consommation, peuvent-ils augmenter les risques liés aux chloramines ?
F. G. Actuellement, la réglementation en vigueur oblige les piscines à faire une vidange complète par an. Des discussions sont menées pour supprimer cette obligation afin de répondre aux exigences écologiques car une piscine olympique représente 2000 m3 d’eau. En termes d’économie de ressource, c’est colossal. Mais quid de la qualité de l’eau ? Est-ce que pour maintenir une qualité suffisante pendant une très longue période il ne faudra pas utiliser plus de chlore et produire plus de composés potentiellement toxiques ? Tout cela doit être discuté et pris en compte dans les choix qui seront faits. En sachant, bien entendu, que la prévention des risques professionnels doit aller de concert avec la protection de l’environnement. C’est le cas, par exemple, lorsque la température d’un bassin est baissée : il y a un gain pour la santé des travailleurs, mais aussi en termes de consommation d’énergie. Lorsque nous développons des solutions de prévention dans nos laboratoires, cette équation est au centre de nos préoccupations.