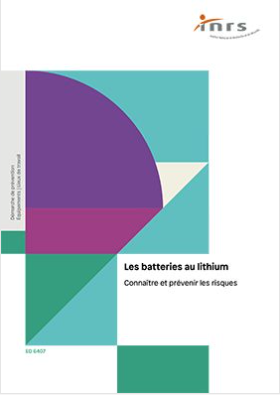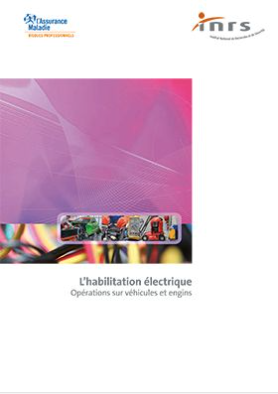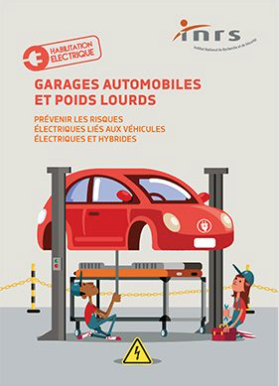Au premier semestre 2024, plus de 1,7 million de voitures circulant en France étaient électriques. L’essor de cette nouvelle génération de véhicules n’est pas sans susciter de nouvelles questions, tant concernant leur usage que leur maintenance. Si la partie roulante (roues, amortisseurs, plaquettes de frein…) est comparable sur véhicules thermiques et électriques, le groupe motopropulseur est très différent. Comptant moins de pièces en mouvement que dans un moteur thermique, un véhicule électrique (VE) nécessite moins d’entretien, et fait appel à une technicité différente.
Ainsi, les VE contiennent deux types de batteries : la batterie de traction, qui stocke l’énergie nécessaire au fonctionnement du moteur et déplace le véhicule, et la batterie de service. Celle-ci alimente les équipements du véhicule (phares, radio…) et est similaire à celles qui équipent les véhicules thermiques. C’est la présence de la batterie de traction, dont le voltage est élevé, et du circuit électrique associé, qui change la donne. « Nous sommes en présence d’une technologie qui demande de nouvelles compétences sur l’ensemble de la filière, de la part de tous les acteurs, depuis le dépanneur qui est le premier intervenant en cas de véhicule accidenté, jusqu’au site de prise en charge des véhicules hors d’usage (VHU) », explique Mimoun Mjallad, expert d’assistance-conseil à l’INRS. On passe ainsi de compétences de mécanicien à des compétences d’électromécanicien, parmi lesquelles : mettre en sécurité le véhicule, localiser les composants électriques, mesurer les tensions, maîtriser le fonctionnement de l’électronique de puissance et de la transmission…
Risque électrique et manutentions
Pour effectuer une maintenance classique, prévue dans le cadre de l’entretien du véhicule, on peut distinguer deux types d’interventions : celles d’ordre non électrique (pneus, plaquettes de freins…) et celles d’ordre électrique. Le risque électrique se présente sous forme d’électrisation, par contact direct ou indirect avec le circuit de traction, et d’expositions à des arcs électriques en cas de court-circuit pouvant notamment provoquer des brûlures. Mais même pour des interventions d’ordre non électrique, le technicien peut être amené à intervenir au voisinage du circuit électrique. C’est pourquoi la norme NF C18-550 indique que la priorité doit être donnée aux travaux hors tension, par consignation du circuit électrique.
Avant toute intervention, il est nécessaire d’être formé à la spécificité du véhicule, chaque modèle pouvant présenter une configuration propre, et prendre connaissance des documents techniques du véhicule. « Mais les documents ne sont pas toujours facilement accessibles auprès des fabricants, ou parfois de façon incomplète », souligne Mimoun Mjallad. Il existe en parallèle des outils de diagnostics permettant d’exploiter les informations fournies par le battery management system, dit BMS. Il s'agit du centre névralgique de l’intelligence de la batterie qui fournit une multitude d’informations sur son état. Toutefois, l’accès aux informations de ce BMS est plus ou moins complexe car, selon les fabricants, il peut nécessiter des outils spéciaux et une haute technicité.
Schéma type du circuit électrique de traction d'un véhicule électrique
La génération d'électricité résultant d'un phénomène électrochimique se produisant au sein de la batterie, le risque chimique doit également être pris en considération. En cas de dysfonctionnement d'une batterie, il peut être dégagé des fumées composées de gaz ou de particules. Ces situations peuvent exposer par inhalation ou par contact cutané à différentes substances, parfois cancérogènes, mutagène, reprotoxiques (CMR) : oxydes de carbone, carbonates organiques, particules métalliques dans les fumées (cobalt, manganèse, nickel, lithium, aluminium…). « La composition des batteries est la plupart du temps compliquée à connaître. On observe fréquemment un décalage entre les composants annoncés par le fabricant et ceux réellement présents », constate Morgane Batteria, chargée de métier véhicules hors d’usage chez Mobilians. C’est pourquoi les manipulations de batteries endommagées nécessitent la présence d’une ventilation générale, la mise à l’écart – si possible en extérieur mais à l’abri des intempéries – de toute substance combustible et le port d’EPI : vêtements étanches aux liquides (de type 3), écran facial, gants de protection, nappe isolante, appareil de protection respiratoire...
Véhicules intègres ou accidentés
Autre source de risque : les manutentions manuelles. Les batteries de traction sont lourdes, de l’ordre de 200 ou 300 kg, parfois plus de 500 kg. Les manipuler nécessite des aides à la manutention et des accessoires de levage spécifiques. Il faut en particulier veiller à avoir des ponts de levage adaptés – idéalement quatre colonnes – car la dépose d’une batterie peut déplacer le centre de gravité et déséquilibrer un véhicule. Il est également nécessaire d’être équipé de tables élévatrices isolantes ou isolées pour accueillir des batteries de traction. Plus largement, prendre en charge des VE nécessite des infrastructures et des équipements particuliers.
Autre cas de figure : les interventions sur un VE à la suite d’une panne ou d’un accident. Dans ce cas, les conditions d’interventions peuvent être différentes. « L’analyse préalable de l’état du véhicule est impérative pour définir des modalités d’intervention en sécurité », insiste Mimoun Mjallad. Trois étapes sont à suivre : identifier le VE afin d’appliquer les instructions du fabricant, et analyser le risque par un contrôle visuel de son état afin de décider de la poursuite des travaux ou de sa mise en quarantaine s’il nécessite l’intervention de personnel plus qualifié. Selon la nature de l’intervention (dépannage, remorquage, secours, expertise, contrôle technique, opérations sur batterie…) et de l’environnement de travail, des habilitations différentes seront nécessaires. Si une intervention est possible, il faudra utiliser du matériel adapté, et ce, uniquement par du personnel formé et habilité. Si le VE est mis en quarantaine, il faudra le positionner en extérieur, dans une zone balisée et à accès restreint, après mise hors tension quand c’est possible.
Incendie-explosion
En effet, l’incendie-explosion, lié à un emballement thermique de cellules de batteries endommagées, demeure le risque n° 1 en matière de gravité. D’autant qu’un feu ou une explosion peut se déclarer plusieurs heures ou jours après un événement déclencheur. Une fois le process engagé, il est quasiment impossible d’enrayer un feu avec les moyens existants. « Les pompiers déjà intervenus sur des feux de VE sont unanimes pour dire qu’il faut laisser un feu de batteries se consumer jusqu’au bout, souligne Morgane Batteria. D’où la nécessité qu’elles soient impérativement dans des zones dédiées et isolées pour éviter la propagation du feu. »
À défaut d’éteindre un feu, ses conséquences doivent être limitées par des mesures d’organisation prises au préalable, au même titre que pour le risque électrique. S’équiper de caméras thermiques peut aider à identifier au plus tôt un début d’échauffement, et permettre de prendre les mesures nécessaires avant l’emballement. Des agents extincteurs sont en cours de développement pour réduire la température émise ou diminuer les gaz et fumées émises par ces feux très énergétiques et émettant un fort rayonnement thermique. Mais pour l’heure, il n’existe pas de solution technique pour éteindre un feu de batterie. D’où l’importance d’une organisation en amont qui ne laisse place à aucune improvisation.