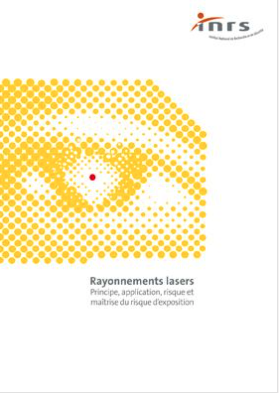Le 6 juin dernier, à deux pas du Stade de France, se tenaient les 15e Assises de la métallerie, organisées par l’Union des métalliers. Lors de cette journée, neuf ateliers thématiques étaient proposés aux professionnels du secteur, parmi lesquels une table ronde intitulée « Soudage laser manuel : une technologie de pointe prête à révolutionner les ateliers de métallerie ? », suivie par 150 personnes.
D’après la présentation, cette nouvelle technique, qui consiste à souder grâce à un pistolet délivrant un faisceau laser, cumule les avantages par rapport aux procédés traditionnels de soudure à l’arc (TIG, MIG-MAG…). D’abord, le soudage laser manuel exigerait moins de préparation et un temps de soudage plus court. « Jusqu’à quatre fois plus rapide que le TIG », apprend-on. Les soudures obtenues seraient aussi de meilleure qualité, nécessitant moins de meulage et de nettoyage en finition. Par ailleurs, la zone affectée thermiquement est réduite par rapport au soudage TIG avec, à la clé, une moindre déformation des pièces soudées.
Seule limite concédée dans la présentation, le soudage laser manuel est adapté à des pièces de faible épaisseur, n’excédant pas 4 mm. Pour le reste, les applications sont multiples et propres à séduire nombre d’utilisateurs (cuisinistes, industries agroalimentaires, chimiques…). D’autant que, dans leurs discours promotionnels, fournisseurs et fabricants mettent en avant son prix attractif.
Problème : pour l’heure, de nombreuses questions de sécurité se posent pour les travailleurs. En particulier : quels sont les nouveaux risques induits par cette technologie ? Quid de la formation des soudeurs qui l’utilisent ? Que sait-on de l’exposition réelle aux fumées de soudage, ou encore aux rayonnements optiques ? Pour la plupart de ces questions, l’état des connaissances est aujourd’hui parcellaire et les solutions de prévention, par conséquent, incomplètes.
Alertes et incidents
« Dès 2023, nous avons été sollicités par le Centre technique des industries mécaniques (Cetim) qui, voyant ce procédé se développer en entreprise, nous alertait sur les problèmes de sécurité que pouvait entraîner sa mise en application », rappelle Thierry Angevin, contrôleur de sécurité au Laboratoire interrégional de chimie de l'ouest (Lico). Parallèlement, le laboratoire a eu échos de plusieurs incidents : lésions oculaires, casque de soudage fondu… Car comparée aux méthodes traditionnelles, la technique génère de nouveaux risques, liés à l’utilisation d’un laser de classe 4. En effet, celui-ci est dangereux pour les yeux et la peau en cas d’exposition au faisceau direct, mais aussi en cas d’exposition au rayonnement réfléchi.
« Dans le faisceau direct, il suffit d’un millième de seconde pour que la rétine soit brûlée de manière irréversible », souligne Virginie Durgeaud, ingénieure-conseil au Lico. Le faisceau peut être dangereux pour les yeux à plus de 100 m, et à plus de 40 m pour la peau. Les rayonnements peuvent entraîner une inflammation de la cornée et de la conjonctive, des lésions de la rétine et des cataractes. Et si le faisceau atteint la peau, il provoque des brûlures qui peuvent être profondes. Sans compter les risques d’incendie si le laser rencontre, par exemple, sur sa trajectoire des produits et matières combustibles (dégraissant, papier…).
« Un soudeur sans formation adéquate va vite se retrouver dans une situation dangereuse, souligne l’ingénieure-conseil. Le faisceau, invisible, peut être dévié et réfléchi, ce qui peut engendrer des émissions diffuses susceptibles de revenir vers lui ou ses collègues. Il y a toute une série de mesures collectives et individuelles à mettre en place pour qu’il puisse travailler en sécurité. »
Comment sécuriser la zone ?
D’abord, selon la réglementation liée aux rayonnements optiques artificiels (ROA), l’utilisation d’un laser de classe 4 nécessite d’avoir, au sein de l’entreprise, une personne compétente en sécurité laser. Responsable HSE, soudeur…, celui-ci devra évaluer les risques et définir les mesures de prévention à mettre en œuvre, notamment les personnes autorisées à utiliser le procédé. Cela pose néanmoins la question de la formation de ces dernières. Si cette rupture technologique induit un changement de métier, les soudeurs devraient-ils suivre une formation spécifique, à la fois pour acquérir la bonne gestuelle et travailler en sécurité ?
D’autre part, ces opérations de soudage doivent se faire dans un lieu dédié, idéalement une cabine entièrement fermée, même au plafond, afin de s’assurer que le rayonnement reste circonscrit et ainsi éviter toute diffusion dans les locaux attenants. La zone d’émission laser doit être signalée (pictogrammes…). « Il est nécessaire de réglementer l’accès à la cabine et qu’un voyant lumineux avertisse lorsque le laser est en route. L’idéal est que son fonctionnement soit asservi à la fermeture de la porte », précise Thierry Angevin. Là encore, une question se pose : dans le cas de dispositifs portatifs, susceptibles d’être déplacés hors atelier, l’installation de ce type de cabine semble difficile à mettre en œuvre. Ainsi, comment la sécurité des travailleurs peut-elle être assurée ? Pour l’heure, il n’existe pas de recommandation sur ce sujet.
Les fabricants et fournisseurs doivent en outre proposer du matériel sécurisé. Mais, à ce jour, les garanties restent limitées. « Souvent, les appareils vendus sur le marché couplent le pistolet à une pince de sécurité qui fait masse, c’est-à-dire que le laser ne peut s’allumer que si le pistolet est en contact avec la pièce à souder. Le problème, c’est que ce dispositif est facilement neutralisable par les utilisateurs », regrette Maxime Berget, expert d’assistance-conseil à l’INRS.
Il est nécessaire de compléter l’arsenal de prévention par des équipements de protection individuelle (EPI). Gants et combinaisons ignifugés, mais aussi, pour protéger les yeux, lunettes de protection laser et casque de soudage auto-obscurcissant. À ce sujet, la Carsat Pays de la Loire, qui consacre une brochure à l’utilisation en sécurité des postes de soudage laser manuel, rappelle que les protections dédiées au soudage MIG/MAG ou TIG ne sont pas adaptées au soudage laser et inversement. « Aujourd’hui, un casque de soudeur classique va protéger des UV, mais pas des IR générés par le laser. Cela donne une fausse impression de sécurité. Il est indispensable de compléter avec des lunettes laser conformes à la norme NF EN 207 », insiste Thierry Angevin. Petit à petit, les fabricants commencent à proposer des casques qui associent les deux protections.
Autre limite des EPI, ils peuvent facilement être oubliés. « Comme le rayonnement laser est invisible, il y a un risque que l’opérateur commence à souder sans ses lunettes. Il faut réfléchir à des systèmes d’alerte en cas d’oubli. Pourquoi pas une caméra avec logiciel de reconnaissance d’image », suggère Guy Le Berre, ingénieur-conseil à la Carsat Bretagne.
Outre les risques liés aux rayonnements optiques, les opérateurs, à l’instar de ceux utilisant des procédés de soudage traditionnels (TIG, MIG…), sont exposés aux risques chimiques liés aux fumées émises. Mais dans quelles proportions ? « Nous manquons de données d’émissions et d’expositions, pointe Myriam Ricaud, experte d’assistance-conseil à l’INRS. La composition des fumées dépend notamment des métaux utilisés. Or, s’il s’agit de souder de l’acier inox, du chrome VI est généré. Même si celui-ci est émis en petite quantité, cette substance est classée cancérogène de catégorie 1B au sens du règlement européen sur la classification, l'étiquetage et l'emballage des produits chimiques (CLP) et l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) a rendu un avis en 2022 recommandant d’inscrire les travaux exposant aux fumées de soudage sur la liste des substances, mélanges et procédés cancérogènes. » Des études sont nécessaires pour évaluer précisément l’exposition aux risques chimiques et évaluer si les valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) sont respectées.
En attendant, la mise en place d’un captage à la source est donc nécessaire et indispensable. Comme il n’existe pas, à l’heure actuelle, de torche aspirante pour le soudage laser manuel, il convient d’opter pour des tables ou des dosserets aspirants. « Voire pour des cabines ventilées si les pièces à traiter sont de grandes dimensions », complète Guy Le Berre.
Pour l'heure, le développement de cette technique s’accompagne de nombreuses interrogations, qui invitent à la prudence. L’INRS conduit actuellement des études sur le sujet, dont les résultats sont indispensables pour établir des recommandations de bonnes pratiques. « Il est nécessaire de rester en veille pour identifier les entreprises qui optent pour ce procédé, d’accompagner les projets en cours et d’évaluer les mesures de prévention mises en place », conclut Guy Le Berre.
UN RISQUE PEUT EN CACHER UN AUTRE
Lorsqu’un opérateur soude des pièces à l’aide d’un laser, il est exposé au rayonnement généré par le procédé. Mais pas seulement… Ce faisant, il va faire fondre du métal. Or, ce métal en fusion provoque un rayonnement secondaire. « Cette zone spécifique, qui va permettre d’assembler les pièces, s’appelle le bain de fusion, note Maxime Berget, expert d’assistance conseil à l’INRS. Pour l’heure, on ne sait pas précisément quelle quantité de rayonnements ultraviolets et infrarouges est émise par cette source, d’autant que celle-ci varie selon les métaux utilisés. » Des études restent donc à mener pour affiner l’évaluation des risques et savoir quelles mesures mettre en place pour bien se protéger.