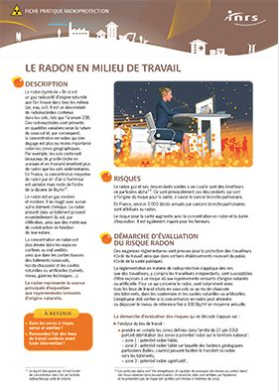Le radon est la première source d’exposition aux rayonnements ionisants en France. Ce gaz radioactif naturel, exhalé majoritairement par les sols granitiques et volcaniques, se retrouve donc partout, dans nos habitats, mais aussi dans le cadre professionnel, en particulier dans les espaces clos mal ventilés où il peut atteindre des niveaux de concentration importants. « C’est le cas des locaux techniques, qui cumulent plusieurs spécificités favorisant sa présence, précise Romain Mouillseaux, expert rayonnements ionisants à l’INRS : ils sont souvent en sous-sol, ils abritent des équipements qui dégagent de la chaleur – ce qui va accentuer le phénomène d’aspiration du radon –, et la présence de gaines techniques qui sortent du sol, fourreaux, tuyaux…, induisent potentiellement des défauts d’étanchéité qui facilitent aussi sa pénétration. »
Or, le radon est classé comme cancérogène certain pour le poumon par le Centre international de recherche sur le cancer (Circ). Depuis le 1er juillet 2018 et la transposition de la directive 2013/59/Euratom en droit français, les entreprises doivent l’intégrer à l’évaluation des risques et prendre des mesures pour réduire l’exposition de leurs salariés. « Celles-ci reposent sur deux grands principes : éviter la pénétration du gaz dans l’espace occupé et améliorer le taux de renouvellement de l’air, via la ventilation, pour tenter de le diluer ou l’expulser », note l’expert.
Amélioration et simplification
Depuis le 7 juin 2024, un arrêté vient compléter ces dispositions. Première précision, le texte reprend le niveau de référence de 300 Bq/m3, déterminée déjà par la directive, comme seuil de déclenchement des actions de réduction de la concentration. Mais il fixe dorénavant un délai maximum de 36 mois pour la mise en oeuvre de mesures pérennes visant à réduire cette concen tration au dessous de 300 Bq/m3, ainsi qu’un délai de 12 mois pour descendre sous la barre des 1 000 Bq/m3 en cas de concentration supérieure à ce niveau. En outre, le plan d’actions adopté doit permettre la traçabilité des mesures mises en place. Autre nouveauté : auparavant, si les mesures de prévention ne suffisaient pas à passer sous le niveau de référence, l’employeur devait calculer la dose efficace susceptible d’être reçue par ses salariés dans l’hypothèse d’un travail à temps plein, soit l’exposition de l’organisme (en millisievert par an), et, en fonction des résultats, instaurer ou non une « zone radon » avec des contraintes spécifiques.
ZONE RADON
La mise en place d’une zone radon soumet l’employeur à plusieurs obligations :
- informer l’IRSN,
- désigner un conseiller en radioprotection,
- délimiter la zone à risque et la signaler au niveau de ses différents accès
- mettre en place des vérifications périodiques avec un mesurage annuel en cas de concentration dépassant 1 000 Bq/m3 et tous les 5 ans si le niveau dépasse 300 Bq/m3,
- informer tout travailleur susceptible d’entrer dans cette zone des risques associés et évaluer individuellement la dose reçue par chaque salarié concerné.
« La nécessité de faire ce calcul pouvait compliquer la mise en oeuvre de la prévention, relève Romain Mouillseaux. L’arrêté simplifie les choses : désormais, la mise en place de la zone radon est uniquement corrélée au fait que l’entreprise a réussi ou non à passer sous les 300 Bq/m3 dans le délai imparti. » Enfin, le texte fait apparaître une nouvelle notion de « zone radon intermittente ». Dans les cas où les travailleurs effectuent une intervention ponctuelle dans des locaux, si l’employeur a les moyens de ventiler le lieu et de prouver, grâce à des appareils de mesurage en continu, que pendant l’opération, les concentrations de radon n’excèdent pas 300 Bq/m3, la zone radon peut être suspendue le temps de l’intervention. « Concrètement, pour l’employeur, cela signifie que certaines obligations associées à la zone radon, en particulier l’évaluation individuelle de la dose d’exposition des travailleurs, sont levées temporairement », résume Romain Mouillseaux.