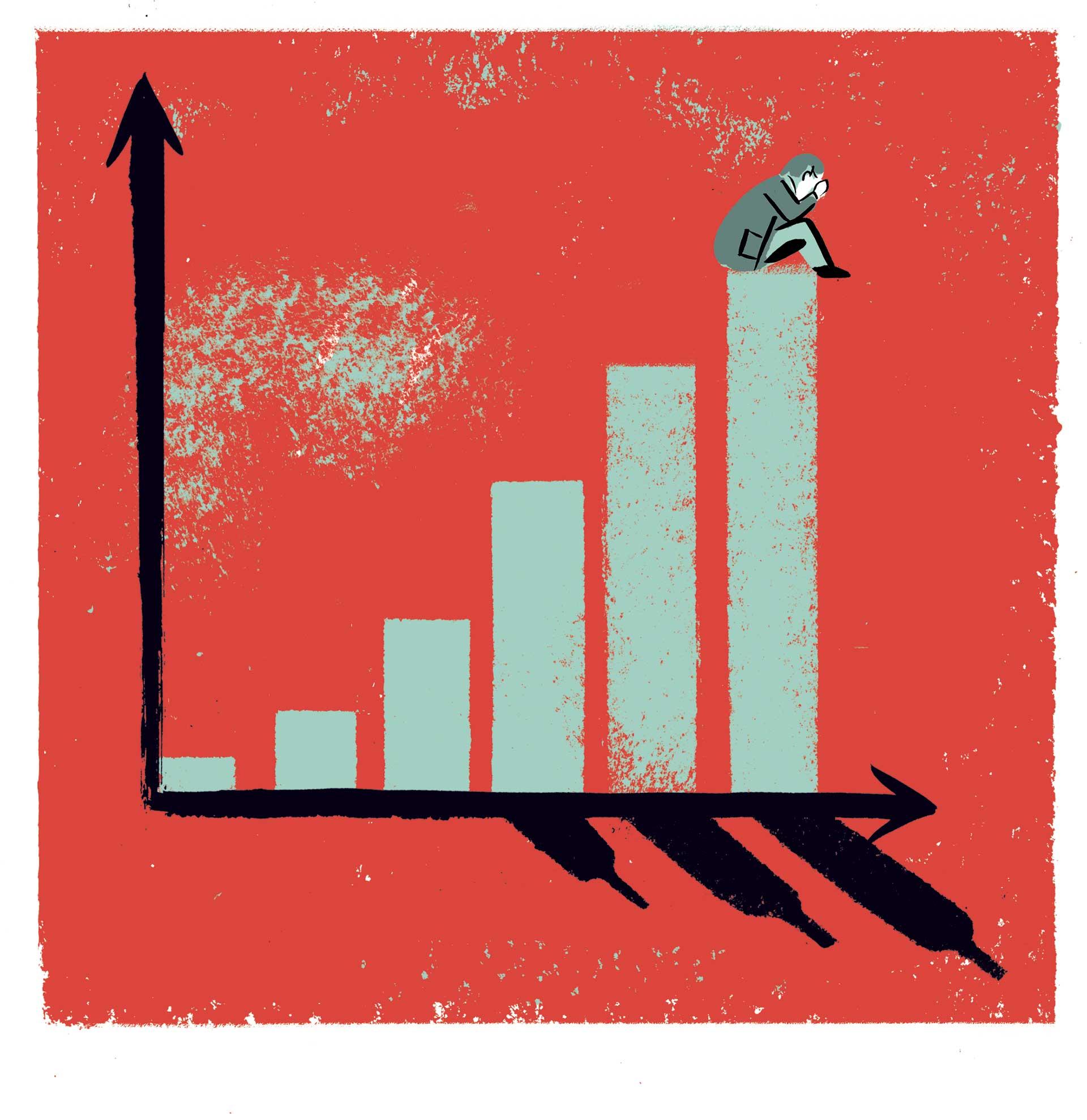Travail & Sécurité. Comment définiriez-vous les conduites addictives ?
Dr Guillaume Airagnes. Les addictions sont avant tout définies par la perte de contrôle. On développe un comportement compulsif, qui peut être associé à un usage de substance psychoactive, et qui a pour objectif de procurer un plaisir immédiat. Le recours à une substance psychoactive peut être lié à la recherche pure de plaisir, mais également au fait d’avoir à supporter une situation de stress – y compris en milieu professionnel –, avoir un visée dopante (pour rester éveillé, concentré, créatif, avoir une activité physique intense…) ou encore pour tenter de réduire les symptômes de souffrance psychologique. Dans ce dernier cas, une personne qui aurait besoin d’un accompagnement psychologique ou même psychiatrique adapté risque de se tourner vers l’automédication et peut tomber dans un engrenage lié au caractère addictogène de la substance utilisée. Toutes ces raisons, bien sûr, ne sont pas exclusives les unes des autres. Des facteurs environnementaux, notamment liés au travail, peuvent créer un terrain propice à un basculement. Certaines pratiques addictives sont favorisées par des formes d’organisation du travail et de relation au travail et ce même si l’on sait que l’emploi a, d’une manière générale, un rôle plutôt protecteur vis-à-vis des conduites addictives. Par ailleurs, il y a des vulnérabilités individuelles. Un usage ponctuel festif chez l’un peut devenir problématique chez un autre.
Travail & Sécurité. Quelles sont ces conditions de travail qui favorisent les addictions ?
Dr G. A. En présence de stress, par exemple, lorsque la charge de travail est trop importante, que le travailleur n’a pas la latitude suffisante pour exercer sa tâche, qu’il n’est pas soutenu par sa hiérarchie ou qu’il ressent un déséquilibre entre les efforts produits et le résultat obtenu, on observe une augmentation de la consommation d’alcool, de tabac ou d’anxiolytiques. Cette augmentation ne s’explique pas uniquement par l’émergence de symptômes dépressifs. Des études ont montré que le travail en tant que tel, lorsqu’il crée des situations de stress ou d’épuisement, peut avoir un rôle pathogène, y compris pour des personnes qui ne rencontrent pas de problèmes dans leur vie personnelle. Avec la cohorte Constances, nous avons spécifiquement mis en évidence un risque lié à la demande émotionnelle. L’exposition professionnelle à un public – qu’il s’agisse d’usagers, de patients, de clients ou d’élèves… – est très associée à une hausse de la consommation de tabac, d’alcool ou de cannabis, en particulier chez les femmes. Le recours aux substances psychoactives pourrait être favorisé par exemple par le besoin de neutraliser ses émotions ou d’afficher des émotions différentes. Les secteurs d’activité qui nous semblaient particulièrement concernés étaient la santé et l’éducation. Agir, tant sur le plan collectif que sur le plan individuel, pour éviter l’exposition à certains risques psychosociaux pourrait permettre de freiner l’apparition de certaines pratiques addictives.
L’ÉPIDÉMIOLOGIE AU SERVICE DE LA CONNAISSANCE
Constances est une cohorte épidémiologique généraliste constituée d’un échantillon représentatif de 200 000 adultes volontaires âgés de 18 à 69 ans, tirés au sort parmi les assurés du régime général de la Sécurité sociale de 17 départements. Elle vise entre autres à étudier les consommations de substances psychoactives des Français et les facteurs cliniques et sociodémographiques qui y sont associés. Il s’agit d’un outil de recherche épidémiologique dont les résultats peuvent participer à l’orientation des politiques de santé publique et de santé au travail. La population étudiée est suivie dans le temps, afin de permettre notamment d’éclairer les relations entre les consommations de substances psychoactives, l’état de santé et diverses composantes environnementales dont font partie les conditions de travail.
Les formes de travail les plus précaires peuvent-elles conduire à une augmentation des pratiques addictives ?
Dr G. A. Dans les liens entre emploi et risques d’addiction, nous n’avons pas retrouvé de sur-risque spécifique chez les travailleurs les plus précaires, qui sont par exemple les travailleurs à temps partiel. Je dirais plutôt que la relation entre les difficultés rencontrées au travail et les addictions concerne tout le monde. Nous avons en revanche montré que l’usage de substances favorise la difficulté d’accès à l’emploi. Lorsque l’on est au chômage, la tendance est de consommer davantage, ce qui participe évidemment à l’augmentation des difficultés d’accès à l’emploi.