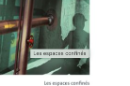En ce début de journée du mois de juin, qui s’annonce caniculaire, Aurélien, Florian et Nicolas, agents au pôle STEA (service technique des eaux et assainissements) de la ville de Paris, et Gaëtan, leur chef d’équipe, débutent une intervention dans le XIe arrondissement de la capitale. Au programme : réaliser l’inspection d’un réseau d’égouts qui courent sous le boulevard Richard-Lenoir et la rue du Chemin-vert. Cette activité de collecte d’informations et de surveillance du réseau consiste à repérer et à recenser des dégradations, des anomalies, des accumulations de matières. Ce travail aidera à prioriser et planifier ensuite les interventions de curage, entretien et autres réparations nécessaires au bon fonctionnement du réseau.
Florian ouvre un premier branchement de regard (BR, ou plaque d’égout dans le langage commun), tandis que Nicolas, 50 mètres plus loin sur le boulevard, en ouvre un deuxième. Tous deux sont équipés de lève-tampons pour faciliter la manipulation des plaques en acier et limiter les efforts, car chacune d'entre elles pèse 80 kg. Le protocole d’accès au réseau d’assainissement a été défini strictement afin que la sécurité lors des opérations soit maximale. « Pour chaque chantier, on distingue six phases, explique Hmida Amrouche, conseiller en prévention à la Direction de la propreté et de l’eau au service prévention et conditions de travail (SPCT). L’accès au réseau, qui représente l’une d'elles, expose à différents risques : manutentions manuelles, chute de hauteur ou de plain-pied, asphyxie en cas de présence de sulfure d’hydrogène ou de monoxyde de carbone… »

Première action, les intervenants attendent 20 minutes avant de descendre, le temps qu’une ventilation naturelle puisse se faire entre les deux branchements de regards ouverts. Pour écarter définitivement tout risque, le « garde-orifice » descend un détecteur quatre gaz (O2, CO, H2S, CH4) afin d'identifier la présence éventuelle d’un gaz toxique. « L’accès au réseau se fait en conformité avec les préconisations du Catec », souligne Catherine Loizzo, assistante de prévention au SPCT. Le Catec (certificat d’aptitude à travailler en espaces confinés, lire l'encadré p. 14) préconise notamment un référentiel commun de formation et de certification pour les travailleurs intervenant sur les réseaux d’eau et d’assainissement.
Durant le temps de ventilation, le binôme qui va descendre s’équipe : combinaison à usage unique, gants, bottes et cuissardes, harnais, casque avec lampe frontale, appareil de protection respiratoire à ventilation assistée, masque autosauveteur, détecteur quatre gaz. Une fois les 20 minutes écoulées, trois mesures de la qualité de l’air sont réalisées, en haut, à mi-hauteur et en bas du BR. Le détecteur ne sonnant pas, Gaëtan et Aurélien peuvent descendre. Si une alarme avait retenti, il aurait fallu attendre 20 minutes supplémentaires avec un nouveau contrôle de l’atmosphère sur les trois points, avant de descendre.
Des entreprises extérieures nombreuses
Ils accèdent l’un après l’autre au réseau souterrain par des échelons, retenus par un harnais et un système de stop-chute à rappel automatique accroché à un trépied. L’une des règles de sécurité est qu’aucun égoutier ne descend seul. La communication à l’aide de talkies-walkies est permanente avec leurs deux collègues restés en surface, chacun positionné à un branchement de regard ouvert. Leur cheminement dans les égouts peut commencer : ils avancent en direction du deuxième branchement de regard ouvert, où est posté Nicolas. Lorsqu’ils arrivent à son niveau, Florian referme le premier BR (d’où ils sont partis) et se rend au troisième, soit 50 mètres plus loin. Et ainsi de suite durant tout leur cheminement. Nicolas et Florian vont ainsi alterner l’ouverture et la fermeture de branchements de regards en surface, de 50 mètres en 50 mètres, au fil de l’avancée de Gaëtan et Aurélien en sous-sol, pour permettre à ces derniers de sortir en cas de besoin. « Est-ce qu’il y a un trou en tête de cheminée ? », demande par talkie-walkie Aurélien à Nicolas. « Oui », répond ce dernier qui peut le vérifier depuis la voirie. La fissure déjà répertoriée lors d’une précédente inspection est ainsi confirmée dans le système informatique.
SYSTÈME D’INFORMATION ET DE GESTION TIGRE
La direction de la propreté et de l’eau de la ville de Paris possède un système d’information et de gestion nommé Tigre (pour « traitement informatisé de la gestion du réseau des égouts »). « Les 2 600 km de réseau y sont répertoriés. Cet outil, renseigné notamment à partir des constats réalisés par les équipes d’égoutiers de la ville de Paris, lors de leurs tournées de collectes, centralise une somme d’informations considérable sur l’état des réseaux, explique Stéphane, responsable de la circonscription Est. Ce recueil nous permet de connaître en temps réel l’état et la configuration du réseau et de son accessibilité, et les difficultés éventuelles. Véritable 'tour de contrôle', c’est un outil efficace pour mieux organiser les tournées et faciliter les interventions. Cela contribue donc à améliorer la sécurité des équipes. Car il ne faut pas oublier qu’en sous-sol de Paris se retrouve le 'négatif' des rues en surface. » De multiples capteurs positionnés un peu partout renseignent en temps réel sur l’état du réseau (niveau d’eau, position des vannes…).
Les conditions d’intervention sont exigeantes, du fait notamment des dimensions du réseau : jusqu’à 2,30 m de haut, et de 1,10 à 1,30 m de largeur. Mais certains passages se révèlent exigus, obligeant les agents à avancer courbés ou accroupis. « D’une rue à une autre, on ne chemine pas de la même façon », remarque Aurélien. Et le tout dans le noir complet, avec l’odeur des effluents : seules les lampes frontales éclairent le chemin, ce qui impose beaucoup de rigueur. « Le travail de collecte est une routine, explique Gaëtan. Les ouvrages se répètent. Le travail de curage est beaucoup plus physique, même si c’est moins pénible qu’avant. »
En cas d’alarme lors du cheminement dans le réseau, si un détecteur de gaz se déclenche, la consigne est de s’équiper du masque autosauveteur et d’évacuer les lieux au plus vite. « Étant donné la répartition des branchements de regards, on n’est jamais à plus de 25 m d’une sortie. L’évacuation d’urgence peut donc se faire rapidement. » Lorsqu’il s’agit d’interventions d’entreprises extérieures dans le réseau d’assainissement, un plan de prévention est élaboré et signé entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise extérieure, après une visite commune et une analyse conjointe des risques. Une fois l’autorisation accordée, l’entreprise extérieure peut intervenir dans le réseau souterrain. Si des outils numériques ont été envisagés pour simplifier les phases d’inspections, et réduire ainsi l’exposition des agents, ils n’apportent pour l’heure pas satisfaction. La présence humaine est donc nécessaire encore longtemps pour réaliser la surveillance dans les égouts.
EN CHIFFRES
- 2 600 km de réseau d’égouts courent sous la ville de Paris – soit la distance Paris-Moscou – complétés par 98 bassins de rétention de différentes formes (carrés, circulaires).
- 46 000 branchements de regards sont comptabilisés dans les rues de Paris, et 110 000 branchements particuliers relient les immeubles au réseau.
- 400 entreprises extérieures et sous-traitants peuvent être amenés à intervenir
dans le réseau sur une année.