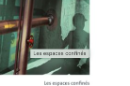Pour les vendanges 2025, la société coopérative agricole La Grenade, implantée à Châteauneuf-du-Pape, dans le Vaucluse, a équipé une vingtaine de cuves de vinification, soit un tiers de son installation, d’un dispositif de captage du CO2 à la source. Le dispositif est simple : un tuyau souple, connecté à la cheminée d’un côté et à une conduite fixe de l’autre, permet au CO2 produit durant la fermentation du moût d’être évacué à l’extérieur du chai, en utilisant son écoulement naturel. « Un litre de vin qui fermente, ce sont 70 litres de CO2 produits, explique Franck Ferraton, directeur de la cave. Notre coopérative fait de la prestation de services pour onze vignerons. On vinifie 10 000 hectolitres de vin par an. Et on sait que la présence de gaz carbonique dans l’atmosphère présente un réel danger. »
Chaque année, le CO2 est responsable de plusieurs accidents mortels en cave lors d'opérations de contrôle du processus de fermentation, de travaux de décuvage ou de nettoyage des cuves.... « Il y avait déjà des extracteurs d’air, déclenchés à quatre heures du matin par les programmateurs, pour garantir le renouvellement de l’air avant l’arrivée des premiers salariés, poursuit le directeur de cave. Mais, ce n’est pas suffisant pendant la période des vinifications. » Alors, quand Claude Rozet, conseiller en prévention des risques professionnels de la MSA Alpes-Vaucluse, lui a parlé de captage à la source, Franck Ferraton n’a pas hésité un instant : « C’est l’avenir du métier et la meilleure façon d’améliorer la sécurité de la dizaine de personnes qui travaillent dans la cave pendant les vendanges. »
Le CO2, un véritable allié pour la vinification
Depuis plusieurs années, la MSA Alpes-Vaucluse creuse le sujet. C’est lorsque le sucre contenu dans le jus de raisin est transformé en alcool par le phénomène de fermentation alcoolique que le CO2 est dégagé. Des mesures, réalisées chez des professionnels, ont permis d’établir que la courbe de production du dioxyde de carbone n’est pas linéaire au cours de la vinification.
« La visualisation par infrarouge révèle qu’en s’échappant de la cuve, le CO2 forme une nappe de quelques centimètres d’épaisseur avant de s’écouler le long des parois pour retomber vers le sol. En fonction des courants d’air, il se diffuse dans l’atmosphère et peut être respiré par les opérateurs », explique Claude Rozet. D’où la nécessité, en premier lieu, de capter au plus près de la source, comme le rappelle la réglementation.

« Il faut également savoir que le CO2 est un véritable allié pour la vinification. En effet, il limite le risque d’oxydation et permet d’éviter les mauvaises fermentations. De ce fait, beaucoup de professionnels ne veulent pas y toucher. Il fallait donc un captage passif, en haut de la cuve en fermentation, qui permette de le laisser s’échapper naturellement dans les tuyaux », complète le conseiller en prévention.
En 2021, pour aider les professionnels à réaliser un suivi des vinifications et à connaître les quantités de CO2 émises par cuve et pour l’ensemble des installations, la MSA Alpes-Vaucluse a développé le site msa-vinification.fr et l'application CO2 Diag'. Bien connaître la dynamique de fermentation se révèle essentiel pour dimensionner son installation de captage à la source et adapter par exemple le diamètre des collecteurs au CO2 produit. Le site donne aux viticulteurs accès à toutes les informations dont ils ont besoin pour le suivi de leur fermentation dans le temps.
Afin de sensibiliser la profession et les apprenants aux risques liés à l’intoxication par le CO2, les préventeurs se sont rapprochés d’un lycée viticole. « Avant les vinifications de 2023, nous avons installé sur l’ensemble de nos cuves à chapeau fixe un circuit de captage passif du CO2 permettant au gaz d’être évacué en dehors du chai, témoigne Roxane Nibaudeau, directrice d’exploitation du Château Mongin, sur le site du lycée viticole Pierre Le Roy de Boiseaumarié à Orange, dans le Vaucluse. Le dispositif n’impacte pas l’activité et ne génère pas de surcharge de travail, même s’il a fallu ajuster certaines pratiques et notamment fermer hermétiquement les cuves. »
Composer avec l’existant
Au moment des vendanges, travailler dans une atmosphère chargée en CO2 donnait parfois une sensation de manque d’air, un peu comme en altitude. « Ce n’est plus le cas maintenant. Le matin, on ne se précipite plus pour aérer, constate la directrice d’exploitation. On ne ressent plus non plus la même fatigue, ni les maux de tête que l’on attribuait peut-être un peu trop vite à la seule charge de travail. C’est un grand pas en avant pour la sécurité de ceux qui travaillent dans la cave, mais aussi dans les bureaux voisins où le personnel pouvait être exposé. »
En début de cursus, un préventeur de la MSA intervient auprès des étudiants sur la gestion des risques en cave. Des journées de sensibilisation sont également proposées aux vignerons. « La principale difficulté, pour installer le dispositif, a été de composer avec l’existant. Il y a forcément moins de contraintes si tout est pensé dès la conception. Nous avons d’ailleurs reçu les représentants d’un domaine, à Gigondas, qui souhaitaient voir notre installation et s’en inspirer pour la construction de leur cave », reprend Roxane Nibaudeau.
CO2, ATTENTION DANGER
En situation normale, l'air extérieur contient environ 0,04 % de CO2. Lors de la vinification, la fermentation du moût entraîne la formation de CO2. Inodore, incolore et plus lourd que l’air, ce gaz a tendance à s’accumuler dans les parties basses et les espaces confinés en l'absence du mouvement d’air. Il existe une valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) au CO2 qui est, sur 8 heures, de 0,5 % en volume dans l'atmosphère de travail.
« Nous travaillons désormais sur l’acculturation des professionnels : vignerons indépendants, coopératives… Un serious game a par exemple été imaginé pour sensibiliser au captage à la source », évoque Éric Argiolas, conseiller en prévention des risques professionnels à la MSA Languedoc, qui rappelle que « le captage à la source n’exonère en aucun cas de la mise en place d’une ventilation générale efficace, ni de l’utilisation de détecteurs mobiles ». Ces détecteurs sont notamment indispensables lors du décuvage, où le travailleur intervient dans la cuve pour extraire les parties solides du raisin.
« Face à un danger mortel, on doit faire le maximum », insiste Franck Ferraton, qui projette, dans les deux ou trois ans à venir d’avoir 100 % de ses cuves équipées de captage à la source. En complément, il envisage une installation qui permettrait de stocker et de compresser le CO2 récupéré afin de le réutiliser pour inerter les cuves vides.
EN BREF
- La MSA met à disposition des outils pour réaliser le suivi des vinifications et quantifier le CO2 émis par cuve et pour l'ensemble de l’installation.
- Le captage à la source, au plus près du point d’émission du CO2, et une ventilation générale sont indispensables pour diminuer la concentration du CO2 dans l’air.
- En complément, il est nécessaire d’assurer une détection permanente du CO2 au moyen de détecteurs fixes (en accordant une vigilance toute particulière à leur localisation) et de détecteurs mobiles.
- Pour toute intervention en cuve, des protocoles d’intervention en espaces confinés doivent être établis. Il est indispensable de ventiler mécaniquement avant et pendant l'opération, d'être équipé d'un détecteur mobile et de supprimer le travail isolé.