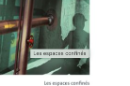Au sein du projet pharaonique de creusement du tunnel euralpin Lyon-Turin (Telt), un seul chantier fait l’objet d’une excavation réalisée entièrement en méthode traditionnelle, c’est-à-dire avec creusement à l’explosif. Situé entre Saint-Julien-Montdenis et Saint-Martin-la-Porte, en Savoie, il s’agit d’un tronçon de 2,8 km qui assurera la jonction entre le réseau ferré existant côté français et le futur réseau transfrontalier. Malgré deux galeries à creuser en parallèle, du fait de leur longueur et de la géologie rencontrée, le groupement d’entreprises a choisi de ne pas recourir à un tunnelier.
C’est pourquoi, depuis l’entrée du tronçon, et sur toute la longueur des deux tubes en cours de creusement, soit 1 921 mètres le jour de notre venue, deux gaines, une bleue et une jaune, courent au plafond des deux galeries. « Le creusement à l’explosif est un procédé très émissif en poussières, qui nécessite une ventilation dédiée et des moyens annexes tels que de la brumisation, explique Pascal Sergi, ingénieur-conseil BTP à la Carsat Rhône-Alpes. On peut y rencontrer divers autres polluants : les gaz issus des moteurs diesel des engins, ceux issus des terrains comme du méthane et du sulfure d’hydrogène, des fragments de clivage issus du broyage de roches, etc. Même s’il peut y avoir des débats sur les limites entre travaux souterrains et espaces confinés, le fait de travailler à de telles profondeurs et dans de telles conditions est assimilable à un milieu confiné. »
Ventilation soufflante et ventilation aspirante
En effet, l’excavation sur ce chantier utilise des explosifs dits liquides (ou émulsion pompée) consistant à employer deux substances qui, une fois mélangées dans les trous de forage du front de taille, créent une réaction chimique et font exploser la roche. Cette opération nécessite une interruption totale de l’activité et l’évacuation de toutes les personnes présentes. L’émulsion obtenue génère de l’oxygène et des quantités importantes d’ammoniac (NH3). La fracturation de la roche met ensuite en suspension dans le tunnel d’importantes quantités de poussières non alvéolaires, de la silice, et des gaz, ce que l’on appelle dans le jargon le bouchon de tir. L’essentiel de ce bouchon de tir s’évacue naturellement en 30 à 40 minutes.
UNE PARTIE DE CHANTIER UNIQUE

© Guillaume J. Plisson pour l'INRS/2025
Le tronçon CO 8 (chantier opérationnel 8) représente un creusement entre Saint-Julien-Montdenis et Saint-Martin-la-Porte, sur une distance de 2,8 km, avec option pour 1 km de plus. Ce chantier consiste en des travaux spéciaux de génie civil et de terrassement, après l’excavation réalisée à l’explosif. Il doit durer 70 mois. Le projet mobilise environ 300 personnes sur site, tourne 7 jours/7 et 24h/24, et représente un budget de 230 millions d’euros de commande. La réalisation des travaux est assurée par la société Telt, qui en est le maître d'ouvrage, détenue à 50 % par l'État français et à 50 % par l'État italien. Le maître d’œuvre est le Groupement Inalpage, réunissant les entreprises Implenia (mandataire suisse), NGE, Itinera et Rizzani de Eccher.
La présence d’une ventilation adaptée permet d’en optimiser l’évacuation depuis le front de taille vers l’extérieur de la galerie dans les gaines destinées à cet effet. La recommandation R 494 de la Cnam Mise en œuvre de dispositifs de ventilation en travaux souterrains linéaires
définit notamment comme principe d’installer une ventilation mécanique en privilégiant conjointement une ventilation soufflante et une ventilation aspirante. Combiner les deux ventilations guide les mouvements du bouchon de tir vers le réseau aspirant et évite la dispersion des polluants dans les galeries. « Sur le terrain, on constate souvent que les grands principes de ventilation de la R 494 ne sont pas toujours bien compris ou pas bien appliqués par les entreprises, constate encore Pascal Sergi. L’apport d’air neuf soufflé n’est souvent pas une priorité. Pourtant, l’installation d’air soufflant procure un gain en matière de santé au travail et de confort de travail. »
La bonne règle est que le conduit d'air aspirant soit au plus près de la source d’émission des polluants, soit une distance d’environ 10 mètres du front de taille, pour un diamètre d’excavation de 8 à 10 mètres, et l’arrivée de l’air soufflant positionnée plus en arrière de l’orifice d’aspiration. « Ce dispositif soufflant-aspirant n’est pas standard en Europe, observe Alexander Heim, directeur de projet chez Implenia Suisse, entreprise mandataire du groupement. Néanmoins, nous l’avons adopté car la prévention fait partie intégrante de notre métier et de nos missions. »
Concilier production et sécurité
« Dès que le tir a lieu, on enclenche l’aspirant puis le soufflant, précise Pierre-Jean Alquier, directeur QPE (qualité, prévention, environnement) chez NGE génie civil. Il y a toujours une inquiétude vis-à-vis de la possible dégradation des gaines lors des tirs, par des projections de fragments de roches. » Les gaines étant installées sur des rails au plafond du tunnel, elles sont reculées le temps du tir et un écran métallique de protection est positionné devant pour empêcher des impacts sur la bouche d’aération. Une manœuvre réalisée à la télécommande. « C’est un dispositif très efficace, en un quart d’heure tout le bouchon est absorbé après un tir, même si on attend toujours une demi-heure avant de reprendre nos postes », témoigne Frédéric Bortolini, chef d’équipe et opérateur tunnelier chez NGE.
Néanmoins, avec l’avancement des travaux, une autre contrainte vient perturber le principe même de ce dispositif. En excavation traditionnelle, le coffrage de la paroi se fait avec des banches circulaires. Afin de respecter les contraintes de logistique et de ventilation, il est admis par le groupement d’entreprises qu’il faut maintenir une distance de 1 000 mètres entre la zone d’explosif et la zone de pose du revêtement. Or le coffrage glissant, mobile, épouse toute la surface de la galerie. Il crée donc un obstacle sur le parcours des gaines de ventilation.
Une des difficultés est alors de maintenir une ventilation efficace. C’est pourquoi, un autre dispositif est prévu dans les toutes prochaines semaines : nommé « Umluft », il s’agit d’un système de ventilation « circulaire », utilisant les deux tubes en cours de creusement. Une galerie fait office de gaine par laquelle l’air neuf provenant de l’extérieur est soufflé, tandis que l’air est évacué par l’autre galerie. « Ce principe permet d’amener de grands volumes d’air avec peu de perte et il demande peu de puissance à installer », poursuit Alexander Heim. De cette façon, l’ouvrage définitif fait partie intégrante du réseau de ventilation et l’outil coffrant ne fait plus obstacle au mouvement d’air.
« Le mode de fonctionnement et l’efficacité du dispositif seront réévalués à partir de mesures réalisées pour le groupement par un laboratoire du chantier, observe Pascal Sergi. Avec ces contraintes rencontrées par le groupement d'entreprises dans un contexte d’adaptation à la R494 pour que la ventilation reste efficace sans porter atteinte ni à la production ni au confort et à la santé des compagnons », conclut-il.
EN CHIFFRES
- 25 postes de travail différents ont été recensés sur le chantier : ferraillage, reprofilage, outil coffrant, nacelles, électricien… Des ventilations secondaires sont installées aux postes, et adaptées aux activités.
- 160 à 170 m3/s c’est le débit moyen d’air nécessaire pour assurer un renouvellement efficace de l'air au sein des galeries en cours d'excavation.
- 4 m/jour c’est la vitesse moyenne de creusement du tunnel. Une à deux explosions ont lieu toutes les 24 heures.