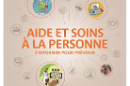« Je te laisse faire, Devon ? » S’aidant de ses bras, l’adolescent se redresse dans son lit. « Avec l’équipe, j’ai découvert que j’étais capable de remonter moi-même le bassin pour m’asseoir au bord du lit », explique-t-il. « J’ai la vidéo de la première fois où il l’a fait. C’était fort », se remémore Émilie Willeron, l’ergothérapeute présente ce matin-là auprès du jeune homme, et formatrice Prap 2S. Le Hameau de Gâtines, à Valençay, dans l’Indre, est un établissement qui accueille des enfants et des adultes présentant une déficience motrice ou un polyhandicap. Les mineurs sont répartis par classes d’âge dans l’institut d’éducation motrice (IEM) et les adultes hébergés dans la maison d’accueil spécialisée (MAS).
EN BREF
Installé sur une parcelle de cinq hectares, le Hameau de Gâtines, appartenant à l’association Vivre et devenir, regroupe dans plusieurs pavillons un institut d’éducation motrice (IEM) pour enfants et adolescents et une maison d’accueil spécialisée (MAS) pour adultes en situation de handicap. Au total, 109 usagers (dont 28 dans la MAS) sont accompagnés par une équipe pluridisciplinaire de 120 professionnels dans un souci de réponse personnalisée et adaptée aux parcours de chacun.
Le cas de Devon illustre les bénéfices de la mise en œuvre d’une démarche ALM – accompagner la mobilité –, sur la prévention de l’exposition des soignants aux risques de troubles musculosquelettiques (TMS) comme sur le maintien en autonomie, les progrès et l’épanouissement de la personne accompagnée. « Tout est parti d’un transfert au cours duquel je m’étais fait mal. J’en ai parlé à Émilie, une fiche a été réalisée et un travail d’analyse pluridisciplinaire initié », explique Virginie Bailly, aide médico-psychologique. « On a filmé la situation initiale, constaté que les capacités motrices de Devon permettaient de travailler sur sa mobilité dans le lit. Depuis, il fait beaucoup de progrès. L'autonomie quotidienne permet un maintien, et la force de ses membres inférieurs est stimulée en rééducation. On réfléchit à des solutions de transfert qui lui permettrait d'avoir plus d'appui sur ses jambes », reprend l’ergothérapeute.
Ne plus faire « à la place de »
« Sans cesse, il faut verbaliser, écouter, évaluer ses capacités sur le moment, car elles peuvent évoluer », poursuit Virginie Bailly. « On me laisse faire ce que je suis en mesure de faire et j’ai repris confiance en moi, commente Devon. Ça m’aide dans le combat quotidien que je mène pour mon objectif de vie autonome. » Pour Cristelle Michaud, monitrice éducatrice, l’ALM est un outil grâce auquel « on ne fait plus à la place de ». Présente dans l’établissement depuis 35 ans, elle a vécu moult transformations. Aujourd’hui, les chambres de l’IEM sont équipées de rails en H. Des tests et investissements réguliers permettent le déploiement d’aides techniques. « C’est nécessaire, mais savoir s’en passer et les utiliser à bon escient l’est tout autant », insiste-t-elle.
Élue au CSE, elle témoigne d’une dynamique d’établissement qu’il faut maintenir au quotidien, « car les habitudes reviennent vite », précise-t-elle. Pour cela, il a fallu se structurer. Tout s’est enclenché en 2023, avec la prise de fonction du directeur, Bruno Campeotto. 37 ans plus tôt, il avait travaillé ici en tant qu’éducateur. À l’époque : ni lit médicalisé, ni rail et, dans les salles de bain, des baignoires classiques… « Nous avions des compétences internes, mais un besoin de structurer l’accompagnement de la prestation et la gestion des risques. J’ai rencontré Luis Dos Santos, contrôleur de sécurité à la Carsat Centre-Val de Loire, qui nous a accompagnés dans ce travail », explique le directeur.
Une première animatrice prévention sanitaire et médico-sociale est embauchée, puis une seconde formée. En lien avec la direction, elles façonnent le projet de prévention de l’établissement, intégrant les spécificités de TMS Pros, réalisant un état des lieux, une hiérarchisation des actions. Un Copil qualité et gestion des risques est mis en place. Quatre formatrices Prap 2S et des acteurs Prap formés au rythme de deux sessions par an complètent le dispositif. « Il en faudrait un ou deux dans chaque pavillon », estime Émilie Willeron. Le jeudi après-midi, les animatrices prévention disposent d’un temps dédié à cette fonction.
Déplacements autonomes
« En région Centre-Val de Loire, un financement de l’ARS permet de compenser ce temps ainsi que l’intervention d’un ergonome en appui des animatrices pour accompagner leur montée en compétences et les rendre autonomes sur l’analyse des risques et l’animation de groupes de travail pour trouver collectivement des solutions adaptées », complète Sandra Lefay, contrôleuse de sécurité à la Carsat Centre-Val de Loire et référente régionale pour le secteur sanitaire et médico-social. Récemment, l’ergonome a accompagné les animatrices sur l’analyse des postes en cuisine et en plonge, ce qui a abouti à une réflexion sur l’amélioration des chariots de cuisine associant les acteurs Prap.
LE BESOIN DE FIDÉLISER
« Depuis la pandémie de Covid-19, on vit une crise des métiers de l’humain, des difficultés de fidélisation des aides-soignantes notamment, constate Bruno Campeotto, le directeur de l’établissement. Or les résidents, comme les familles, ont besoin de repères. La montée en compétences en prévention nécessite aussi une fidélisation, poursuit-il. Un fort turn-over crée des moments de fragilité. C’est néanmoins une réalité que l’on essaie de dépasser. »
Désormais, l’établissement est en capacité d’analyser les situations de travail. Et à l’IEM, de mettre en œuvre des solutions favorisant les déplacements autonomes. « C’est parfois un travail d’essais et d'erreurs successifs. Pour Ahamadi, on a aménagé un tapis et adapté une barre fixée au lit : il peut passer seul du fauteuil au lit et s’habiller. Je n’interviens qu’à sa demande et ne prends pas le risque de me blesser », explique Françoise Davenel-Noël, une autre ergothérapeute. L’adolescent, lui, est ravi.

De l’autre côté du couloir, son copain Eliott souhaitait pouvoir lui-même passer du fauteuil électrique au fauteuil manuel avec lequel il joue à la boccia - un sport de boules proche de la pétanque pratiqué par les personnes en situation de handicap en catégorie handisport. Les professionnels ont réaménagé la chambre afin de lui laisser de l’espace pour effectuer seul ce transfert en passant par le lit. Assis sur ce dernier, il déplace son coussin d’un fauteuil à l’autre. Chaque situation est unique. « Dans un autre cas, celui d’un jeune appelé Théo, une collègue qui s’était fait mal réclamait un lève-personne avec sangle, ce qui n’aurait pas été adapté pour un enfant qui se tient debout. Elle utilise maintenant un guidon de transfert aménagé à sa hauteur », décrit Émilie Willeron.
Emma, quant à elle, a très peu d’autonomie. Dans sa chambre, un lit multipositions d’aide à la latéralisation permet aux soignants, avec le rail plafonnier, d’allonger la jeune fille et de la caler de côté sur son installation de nuit faite de mousse. « Un jour où je m’étais retrouvée seule à la mettre en place, j’ai pris un bon coup de chaud », explique l’ergothérapeute. L’analyse de la situation a conduit à cet essai de lit, qui répond aussi à un souhait de la jeune fille : celui de protéger les personnes qui prennent soin d’elle.
« UNE PLUS-VALUE POUR NOS MÉTIERS »

Il y a cinq ans, Émilie Willeron a été formée actrice et formatrice Prap 2S. Récemment, elle a suivi une nouvelle fois la formation avec le complément ALM. Depuis 2024, deux sessions annuelles de formation d’acteurs Prap sont organisées dans l’établissement. « On en mesure pleinement la plus-value pour nos métiers, notamment à travers les méthodes d’analyse que l’on transmet aux collègues », explique-t-elle. À l’IEM, l’ALM a permis de révéler chez les enfants des capacités insoupçonnées, contribuant à renforcer leur autonomie et leur épanouissement.
© Philippe Castano pour l'INRS/2025