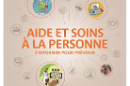Se redresser ou se tourner dans son lit, s’asseoir dans un fauteuil ou s’en extraire, marcher jusqu’à sa salle de bain… Autant de déplacements que chacun réalise naturellement lorsqu’il est en bonne condition physique mais qui peuvent devenir complexes, voire carrément impossibles, lorsque le corps n’est plus en mesure d’effectuer certains mouvements élémentaires. C’est une réalité que connaissent bien les professionnels de la santé et de l’aide à la personne qui s’occupent de personnes malades, blessées, âgées ou porteuses de handicaps. Qu’il s’agisse de leur administrer un traitement, de les conduire en salle d’examen ou de les accompagner dans les gestes de tous les jours (repas, toilette, activités…), les infirmiers, aides-soignants et autres aides à domicile sont amenés quotidiennement à soulever, tirer, pousser, soutenir, retenir… Des ports de charge qui sont la principale cause d'accidents du travail, de maladies professionnelles et d’inaptitudes de ces travailleurs selon les chiffres de sinistralité du secteur.
L'ALM EN PRATIQUE
Les déplacements au quotidien, même les plus simples, sont composés d’une série d’actions élémentaires. Pour se rehausser dans un lit, par exemple, une personne parfaitement valide remonte les pieds et les coudes pour créer quatre points d’appui. Elle soulève ensuite le bassin, pousse sur les pieds et bascule sur les coudes, pour enfin se reposer à nouveau dans le lit. Il suffit qu’une de ces étapes ne soit pas réalisable, à cause d’une blessure au coude, par exemple, ou d’une incapacité à mouvoir ses membres inférieurs, pour empêcher l’ensemble du déplacement. Ainsi, un patient capable de pousser sur ses jambes et de tirer sur ses bras, mais pas de s’appuyer sur ses coudes pourra, avec une poignée de traction et une assistance verbale se rehausser de lui-même dans son lit. Si celui-ci n’est pas équipé de poignée de traction, un drap de glisse sous le haut du corps est une autre solution permettant au patient de se repositionner seul sur sa couche.
Pour réaliser les manipulations de patients, la prévention s’est longtemps appuyée sur les « bonnes » pratiques de portage enseignées dans les formations « gestes et postures ». L’objectif était d’adopter une gestuelle optimale dans la manutention de charges inertes et elles sont malencontreusement toujours au programme des formations initiales d’aide-soignant et d’infirmier. « Or, si l’on se réfère à la définition du soin, à savoir qu’il s’agit d’actions menées pour maintenir ou rétablir l’autonomie, cette approche qui impose de rendre le patient passif n’est pas bénéfique pour lui, bien au contraire. Sans sollicitation, les capacités se dégradent encore plus, explique Carole Gayet, experte d’assistance-conseil à l’INRS. Un cercle vicieux qui expose davantage les professionnels aux risques liés au port de charge. » Alors comment réaliser des transferts afin non seulement de préserver la santé du soignant mais aussi de favoriser l’autonomie du patient ?
Des soins de manutention
Ces dernières années, une nouvelle doctrine est apparue en la matière. Et depuis 2021, l’accompagnement de la mobilité de la personne aidée en prenant soin de l’autre et de soi (ALM) a remplacé les techniques de mobilisation dans les programmes des formations à la prévention dans le secteur de l’aide et du soin à la personne. Initiée par des soignants et ergonomes de l’hôpital Saint-Joseph de Paris, sous l’appellation « soin de manutention » et promue par l’INRS, la démarche ALM intègre la prévention au cœur même des pratiques de soin grâce à un nouveau cadre de référence. Elle repose notamment sur l’évaluation par le professionnel des capacités du patient, ou du bénéficiaire, à réaliser en autonomie chacun de ces mouvements élémentaires.
En identifiant ce que la personne aidée peut faire elle-même et ce qu’il faut compenser, le soignant peut construire un scénario de déplacement en choisissant le type d’assistance adaptée aux différentes étapes du déplacement. « L’évaluation a lieu à chaque fois que le patient doit se déplacer car ses capacités évoluent dans le temps. Elles peuvent s’améliorer, notamment pour les personnes se remettant de maladie ou d’une chirurgie, ou décliner, par exemple pour les personnes vieillissantes ou souffrant de diverses pathologies, souligne Cyrille Bertin, coordinateur prévention à l’hôpital Saint-Joseph. Il peut même y avoir des variations sur une même journée, voire d’une heure à l’autre, avec des personnes capables de réaliser des mouvements le matin qu’elles ne peuvent plus reproduire plus tard, ou inversement. »

Accompagner un déplacement ne consiste donc jamais en une formule générique, une recette unique applicable à tous les individus. Concrètement, il s’agit d’évaluer tout au long de l’accompagnement, à la fois l’environnement, les capacités de la personne et les risques (pour le patient et le professionnel) à réaliser le déplacement. Pour apprécier ses capacités à tenir debout par exemple, le soignant ou l’aidant pourra lui demander préalablement de maintenir sa jambe droite levée et tendue six secondes, puis la gauche. Il donne ensuite une consigne à la personne aidée afin qu’elle réalise seule son déplacement. Si elle n’est pas en mesure de le faire, le soignant l’encourage à réaliser chacune des étapes qui constitue le déplacement afin de la faire changer de position par elle-même.
Des outils d'aide adaptés à la personne et aux circonstances
« En guidant une personne avec la voix et des gestes, on peut réaliser un déplacement ou tout au moins une partie, affirme Philippe Claudel, chargé de projets formation à l’INRS. Ce n’est que lorsque le patient ne peut pas faire que le soignant intervient soit physiquement, dans la limite d’un effort qui ne doit pas être dangereux pour sa propre santé, soit en ayant recours à un outil d’aide qui ne vient pallier que les capacités abolies. » Pour cela, il existe de nombreux outils d’aide à la manutention de personne comme, pour n’en citer que quelques-uns, les draps de glisse, les poignées de traction, les lève-personnes sur rails ou mobiles, les verticalisateurs, les matelas aéroglisseurs…
DOMUSVI : UN RÉSEAU DE FORMATION INTÉGRÉ
DomusVi est un acteur de l’habitat, des services et des soins dédiés aux personnes âgées. Engagé pour les conditions de travail de ses salariés, il a signé plusieurs conventions de partenariat avec l’INRS depuis 2015. « La mise en pause pendant la pandémie de Covid de nos premières expérimentations du soin de manutention, que nous appelons en interne soin d’autonomie, initiées en 2019, nous a permis de prendre un peu de recul sur l’impact de la formation, raconte Corentin Travers-Lesage, directeur organisation et santé au travail de DomusVi. Nous avons repris son déploiement en 2021 avec le plein soutien de la direction générale, avant de nous raccrocher dès le début de l’année 2022 à la nouvelle mouture du référentiel Prap 2S qui intègre cette démarche sous l’appellation ALM. Afin d’être autonomes dans ce projet, nous avons créé un réseau important, composé à l’heure actuelle de 74 formateurs internes, qui seront rejoints par dix autres collaborateurs d’ici la fin de l’année. Nous avons ainsi pu former 790 acteurs en 2022, 993 en 2023 et 1 060 en 2024. Les résultats sont significatifs : le turnover parmi nos salariés formés a diminué de dix points par rapport au turnover global de l'entreprise. » « Afin de porter ce réseau, j’ai été certifiée formatrice de formateurs en 2023 et j'ai pris en charge son animation en organisant des webinaires et un séminaire annuel permettant les échanges de bonnes pratiques, énumère Audrey Blanquer, responsable organisation et prévention au sein de la même entreprise. C’est impressionnant de voir l’enthousiasme que soulève la démarche, même chez les collaborateurs réticents au premier abord. Après ces quatre jours, ils nous remercient des perspectives d’améliorations de leurs conditions de travail que leur a ouvert ce changement de paradigme. Ils ne reviendraient à leurs anciennes pratiques pour rien au monde. »
« Il faut être vigilant car certains dispositifs proposés sur le marché peuvent être contre-productifs, voire dangereux, alerte Carole Gayet. S’ils gênent le mouvement que peut encore faire un patient ou s’ils imposent des efforts physiques trop importants au soignant, notamment, c’est soit qu’ils ne sont pas intégrés à bon escient – avec la bonne personne et au bon moment – soit qu’ils ont été mal conçus et devraient donc tout simplement être retirés de l’organisation de soins. »
Ce sont ces connaissances des gestes simples qui composent les déplacements ainsi que des possibilités des aides à la manutention et de leurs limites, qui peuvent permettre aux professionnels du soin d’entrer pleinement dans la démarche ALM et de la mettre en œuvre sur le terrain. Les formations certifiantes de formateurs ainsi que de formateurs de formateurs des dispositifs Prap 2S (prévention des risques liés à l’activité physique dans le secteur sanitaire et médico-social) et ASD (aide et soin à domicile) de l’INRS et du réseau Assurance maladie-risques professionnels ont pour objectif de prodiguer ces enseignements.

Certaines entreprises du secteur choisissent d’ailleurs d’intégrer des formateurs, plutôt que d’avoir recours à des organismes extérieurs. En se dotant en interne d’un tel apport, ces structures gagnent en efficacité de déploiement mais également en continuité : tout nouvel embauché peut rapidement bénéficier d’une session d’apprentissage. Cela permet aussi une meilleure animation de la démarche grâce à des échanges réguliers sur les difficultés rencontrées, les bonnes pratiques, les cas particuliers, les acquisitions et les tests de matériel… De la même façon, les formateurs peuvent participer à la résolution de situations d’aide au déplacement inédites ou complexes auxquelles sont confrontés les professionnels.
Se former régulièrement
Si le maintien et l’actualisation des compétences sont assurés par des recyclages, prévus tous les deux ans pour les acteurs et tous les trois ans pour les formateurs, des rappels réguliers sont intéressants pour éviter que le naturel ne revienne au galop. En effet, les cursus initiaux des soignants leur inculquant qu’aider c’est « faire à la place de », le réflexe de porter peut ressurgir facilement, notamment face à une situation inédite, comme des incapacités inhabituelles, une situation d’urgence ou l’indisponibilité d’un outil d’aide à la manutention.

« Le changement de paradigme complet qu’impose l’ALM peut être un frein pour certains soignants, confirme Carole Gayet. Ils se laissent plus facilement convaincre en mettant en avant l’amélioration des soins prodigués aux patients plutôt qu’en évoquant leurs conditions de travail qu’ils font souvent passer au second plan. Pourtant, dès qu’ils commencent en formation à découvrir réellement la démarche, les professionnels sont généralement vite convaincus par les ateliers pratiques qui en démontrent l’efficacité. »
Les stages dédiés aux dirigeants sont aussi un bon moyen de lever des réticences, souvent liées au temps à dégager pour former les équipes ainsi qu’aux investissements nécessaires à l’acquisition d’outils d’aide à la manutention de personnes. Outre les ateliers pratiques qui mettent les dirigeants dans la peau de soignants et de patients, la présentation du retour sur investissement qu’ils peuvent réaliser grâce à la diminution des jours d’arrêt et du turn-over est un argument de poids pour emporter l’adhésion des décideurs. Cette dernière est en effet primordiale pour réussir le changement de culture que représente pour les soignants le passage à la démarche ALM.
2S, FORMATEUR PRAP 2S, GESTES ET POSTURES : QUELLES DIFFÉRENCES ENTRE CES FORMATIONS ?
- Acteur Prap 2S. Cette formation de 4 jours a pour objectif d’enseigner au salarié des compétences lui permettant d’observer et d’analyser sa situation de travail afin d’identifier les atteintes à la santé susceptibles d’être encourues, mais aussi de participer à la maîtrise du risque en proposant des solutions d’amélioration et en devenant un relais de la prévention dans l’entreprise. Il est également formé à la démarche ALM.
- Formateurs Prap 2S. D'une durée de 14 jours, cette formation s’adresse aux personnes chargées de déployer le démarche Prap en interne et de former des acteurs Prap. Outre les compétences précitées (observation et analyse des risques liés à une situation de travail, proposition de pistes d’amélioration, suivi de leur mise en place…), le stagiaire apprend à élaborer un projet de formation Prap intégré à la démarche de prévention de l’entreprise ; à organiser, animer et évaluer cette formation et à exploiter la démarche ALM pour développer des situations d'apprentissage.
- Gestes et postures. Plus courte et ponctuelle que les précédentes, ce type de formation consiste à enseigner des postures à adopter pour limiter les contraintes physiques lors de port, déplacement ou manipulation de charges. Elle est centrée sur le comportement individuel du salarié, mais ne s’inscrit pas dans une démarche globale de prévention des risques professionnels. Depuis 2002, l’INRS préconise la formation Prap plutôt que celle-ci.