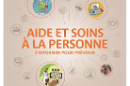C’est en 2006, à l’occasion de la fusion de leurs deux établissements, que Jean-Philippe Sabathé, infirmier/ergonome et formateur Prévention des risques liés à l’activité physique dans le secteur sanitaire et médico-social (Prap 2S) à la maternité Notre-Dame-de-Bon-Secours, croise la route de Bernard Venaille, cadre kinésithérapeute à l’hôpital Saint-Joseph. « Nous nous intéressions tous deux aux moyens de réduire les risques liés aux manutentions de patients. Mais nous n’avions pas la même approche, raconte Jean-Philippe Sabathé, aujourd’hui responsable du département prévention des hôpitaux Paris Saint-Joseph et Marie-Lannelongue. J’étais orienté outils d’aide dans la réalisation du déplacement, tandis que Bernard interrogeait les possibilités offertes par les capacités résiduelles des patients à se mouvoir. Autant vous dire que l’on ne s’est pas compris tout de suite. »
Ils finissent toutefois par s’accorder : pour protéger les soignants, il faut supprimer les portages délétères. Comment ? En s’appuyant sur la connaissance des déplacements spontanés et des mouvements élémentaires associés, même les plus limités, réalisables par les patients.
UNE DÉMARCHE EN FAVEUR DU MAINTIEN DANS L'EMPLOI
En 2010, l’association Objectif emploi des travailleurs handicapés (OETH) attire l’attention de Jean-Pierre Sabathé sur le cas des salariés en restriction qui, en revenant sur le terrain, se retrouvent à devoir réaliser des portages. « Cela nous a encouragés à mettre la barre encore plus haut. Nous avons poussé la logique de notre démarche pour qu’elle permette de réaliser des manutentions au moindre coût physique “avec deux doigts”, indique le co-créateur du soin de manutention. C’est une formule choc pour marquer les esprits, mais le soin peut réellement être mis en œuvre quelles que soient les capacités physiques des soignants. » Cette volonté d’être inclusif, qui participe au maintien dans l’emploi, fonctionne comme le démontrent les formations réussies de salariés porteurs de handicaps. « Certains avaient des doutes quant à leur capacité à aller au bout de l’apprentissage, mais ils y sont parvenus sans problème », s’enthousiasme Jean-Philippe Sabathé.
Ensemble, les deux hommes construisent une démarche qu’ils baptisent « soin de manutention », car si elle protège les salariés des établissements de santé, elle propose avant tout d’envisager désormais la manutention comme un soin à part entière. Elle stimule les patients et favorise leur autonomie. « Lorsque j’ai découvert cette approche en 2017, j’ai compris qu’elle était plus pertinente que les bonnes pratiques de portage qui étaient jusque-là de mise dans le réseau prévention », se remémore Carole Gayet, experte d’assistance-conseil à l’INRS.
Ainsi, une convention de partenariat est signée en 2018 entre l’hôpital Saint-Joseph et l’institut pour déployer largement la méthode. Intégrée en 2021 à l’offre pédagogique de la branche prévention sous le nom de démarche ALM, pour « accompagner la mobilité », elle est intégrée en quelques années dans les référentiels des formations, initiales et continues, des professionnels du soin et de l’aide à la personne. « Elle ne se substitue pas aux dispositifs existants, elle les complète, précise Carole Gayet. Comme toute action de prévention, elle ne se suffit pas à elle-même, mais doit s’inscrire dans une démarche globale. »
Apprendre et diffuser les bonnes méthodes
Une assertion confirmée par le programme de la formation « référent prévention troubles musculosquelettiques (TMS) » dispensée par l’équipe du centre de ressources de l’hôpital Paris SaintJoseph, là où tout a commencé donc. Outre le soin de manutention en lui-même, le stage aborde aussi l’analyse de l’activité, l’ergonomie, la réglementation, la conception des postes de travail, la psychodynamique du travail... « Au terme de treize jours d’apprentissage en trois sessions, les participants sont capables d’animer la démarche de prévention des TMS de leurs établissements en s’appuyant notamment sur le soin de manutention qu’ils diffusent à leurs collègues au travers de formations qu’ils conçoivent et animent eux-mêmes », souligne Martine Vanderbroucke, ergonome des hôpitaux Paris Saint-Joseph et Marie-Lannelongue et formatrice au sein du centre de ressources.

En cet après-midi de début juin 2025, six stagiaires – aide-soignante, infirmière, psychomotricienne ou encore ergonome –, sont au 3e jour du dernier module de cette formation. Les travaux pratiques consistent en des mises en situation s’appuyant sur les connaissances acquises. Les stagiaires qui endossent le rôle de patient sont discrètement briefées sur leurs capacités à se mouvoir par Cyrille Bertin, coordonnateur prévention à l’hôpital Saint-Joseph. Ainsi, celles qui enfilent le costume de soignantes construisent le déplacement dans des conditions proches du réel. Le jeu de rôle démarre. « Que voulez-vous, madame ? Aller dans votre fauteuil ? C’est d’accord. Ramenez votre jambe droite vers moi », dit la stagiaire « soignante » en tapotant sur le tibia de la stagiaire « patiente »…
La prestation est ensuite décortiquée. Les capacités de mouvement de la patiente ont-elles été bien mises à contribution ? Était-il nécessaire d’avoir recours au lève-personne suspendu au rail en H de la salle de formation ? Les avis diffèrent. « Elle aurait pu aller plus loin en demandant à la patiente guidée jusqu’à la position assise au bord du lit de se pencher en avant pour lui permettre de se lever par ses propres moyens, concède Cyrille Bertin. Mais je vous rappelle qu’il peut y avoir différentes solutions pour réussir un transfert sans porter, cela dépend des capacités du patient que nous avons évaluées. »
Se déprogrammer des formations antérieures sur le portage
« La formation est très riche. Il faut assimiler chacun des mouvements élémentaires ainsi que les déplacements qu’autorisent leurs différentes combinaisons, maîtriser les caractéristiques et fonctions des aides techniques pour les intégrer dans le soin au moment opportun…, récapitule pour sa part Anaïs Romain, préventrice à l’hôpital franco-britannique de la fondation Cognacq-Jay. Ce n’est pas un mode d’emploi à suivre, mais toute une grammaire qu’il faut s’approprier pour être capable de s’adapter en fonction des capacités du patient, du matériel et même de l’aménagement des locaux. »
« Abandonner les portages qui nous ont été enseignés au cours de notre apprentissage du métier, se déprogrammer, est certainement la difficulté principale », pointe Stéphanie Zemmouri, infirmière en santé au travail à l’hôpital de Melun. « Mais la méthode est vraiment efficace, rebondit Marion Ollivier, psychomotricienne dans un Ehpad de Nanterre. C’est impressionnant de voir que l’on peut aider au transfert d’un patient sans fournir d’effort physique. Cela paraît presque magique. » Un discours de bon augure pour le retour des stagiaires dans leurs établissements respectifs.
DES AIDES À LA MANUTENTION... PAS TOUJOURS AIDANTES
De nouveaux outils de manutention de personnes arrivent régulièrement sur le marché. Il est donc utile d’organiser une veille sur ces propositions afin de vérifier si certaines d’entre elles peuvent s’intégrer à la démarche de soin de manutention, quels mouvements permettent-elles de pallier et à quel moment leur utilisation peut être utile. « Il arrive que des outils d’aide soient carrément non recommandables, souligne Carole Gayet, experte d’assistance-conseil à l’INRS. Je pense, par exemple, à une veste munie de poignées au niveau des épaules et des hanches qui, portée par un soignant, doit permettre au patient de s’y agripper pour se lever de son siège. Ainsi, le professionnel est utilisé comme un outil : il doit tracter tout en faisant contrepoids avec son corps pour garder l’équilibre, au risque d’être précipité en arrière lorsque le patient arrive en position verticale. »