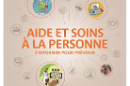L’Association hospitalière Nord Artois cliniques (Ahnac) plonge ses racines dans le passé minier du nord de la France. Elle est en effet née du regroupement, en 1977, de plusieurs cliniques fondées au début du XXe siècle qui étaient dans un premier temps réservées aux gueules noires et à leurs familles, avant de s’ouvrir petit à petit à l’ensemble de la population. Presque 50 ans après sa création, l’association, qui regroupe 24 établissements répartis en douze sanitaires et douze médico-sociaux, emploie plus de 3 000 collaborateurs.
En 2018, alors que le groupe Ahnac est en recherche de solutions permettant de réduire les troubles musculosquelettiques et les accidents liés au port de charge tout en garantissant le bien-être des patients et résidents, la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne (Fehap) lui apprend l’existence du soin de manutention. « Une technique permettant d’accompagner les résidents lors de transferts en ne se servant que de deux doigts ? J’étais plutôt dubitatif, confie Éric Batecave, directeur du pôle médico-social de l’Ahnac. L’équipe de l’hôpital Paris Saint-Joseph, à l’origine de la démarche, nous a démontré son efficacité. Nous avons été bluffés. »
Remporter le soutien des décideurs
En conséquence, treize salariés sont formés pour être référents et faire, dans les établissements du groupe, la promotion de la démarche dont la finalité est la suppression des portages délétères. Mais ils se heurtent à une mauvaise coordination et aux directions qui rechignent à dégager du temps pour former les équipes et investir dans du matériel d’aide à la manutention, outils qui constituent, avec la connaissance des gestes résiduels, les deux piliers du soin de manutention.
BON POUR LES AIDANTS…
Selon le suivi réalisé par le comité de pilotage de la démarche de soin de manutention de l’Ahnac, les accidents du travail ont baissé de 59 % entre 2020, année de sa mise en œuvre au pôle médico-social, et 2024. Et en matière de causes, les accidents liés aux manutentions ont reculé de 89 %. Sur la même période, les douleurs les plus fréquemment citées par les salariés – épaules, nuque, milieu et bas du dos – sont également sensiblement moins nombreuses. Dans l’Ehpad Denise-Delaby, la future installation de rails en H dans chacune des chambres de l’établissement, dans le cadre du projet de restructuration, va certainement accentuer cette tendance en complétant les aides à la manutention déjà utilisées. Pour bénéficier d’améliorations des conditions de travail du même acabit, du côté du pôle sanitaire de l’Ahnac la révolution est également en marche : les premières formations au soin de manutention ont été organisées en 2023.
« C’est grâce à la formation qu’ils ont suivie à Saint-Joseph que nous avons pu remporter le soutien des décideurs, affirme Éric Batecave. Ils ont eu la possibilité de constater les gains en matière d’efforts que présente un transfert conçu avec cette méthode et la baisse de sinistralité observée dans l’hôpital parisien. » Les directions deviennent ainsi moteur dans le déploiement de la démarche, et dégagent des moyens, notamment financiers.
Et c’est à partir de 2020, qu’ont lieu les premières acquisitions de matériel en adéquation avec la démarche (draps de glisse, lits cinq positions…). Dans le même temps, le soin de manutention a été déployé dans le pôle médico-social de l’Ahnac avec succès grâce au concours d’un intervenant extérieur formé lui aussi aux soins de manutention à Saint-Joseph.
Une affaire qui porte ses fruits
Toutes les infirmières et aides-soignantes ont aujourd’hui été formées aux mouvements spontanés, techniques d’évaluation des capacités motrices des résidents et caractéristiques des outils d’aide à la manutention permettant de les utiliser à bon escient. « Il nous a fallu trois ans pour former tous les salariés de nos établissements médico-sociaux, soit environ 300 personnes, indique Véronique Delplanque, ancienne infirmière qui, après avoir été actrice de la démarche, vient d’accéder à la fonction de formatrice pour l’ensemble des structures de l’Ahnac, après le départ de son collègue à la retraite. Maintenant, nous formons les nouveaux arrivants au fil de l’eau. »
Et cela fonctionne, comme l’indiquent la baisse des accidents et les témoignages des professionnels, à l’image de ceux de l’Ehpad Denise-Delaby de Liévin, une des structures de l’Ahnac. « J’ai eu une hernie discale, une capsulite… J’évitais les résidents les plus lourds, se remémore Annick Nicolle, aide-soignante et référente soin de manutention de l’établissement. Dorénavant, je peux tout faire. Remonter une personne dans son lit est facile lorsque l’on sait comment la mobiliser et utiliser un drap de glisse. » « Avant, la toilette complète au lit était la norme. On ne se posait pas de question, se remémore Isabelle Fenzy, infirmière coordinatrice de l’Ehpad. Maintenant, cela ne concerne que cinq ou six de nos 60 résidents. Les autres peuvent être accompagnés au lavabo ou à la douche en exploitant les gestes qu’ils sont encore capables de faire et les aides permettant de pallier ceux qui sont abolis. » Un vrai plus pour la santé et le moral des résidents aussi.

Pour déployer et animer la démarche de manière coordonnée dans les différents établissements du pôle médico-social, un comité de pilotage a été mis en place dès le début du projet. Composé des directeurs, du responsable qualité, des référents soins de manutention, des infirmiers de coordination, du formateur, de la responsable RH et du DRH, il se réunit trois fois par an. Échanges sur les bonnes pratiques, points d’étape, identification de ce qui marche et de ce qui ne marche pas ou encore remontées des problèmes de matériel, qu’il s’agisse de demander des réparations ou des acquisitions… Ces réunions impulsent et maintiennent la dynamique de la démarche.
« Les améliorations des conditions de travail ont abouti à moins d’arrêts, de turn-over et de désorganisation. Notre équipe est soudée, l’ambiance est bonne… La preuve ? Les stagiaires et jeunes diplômés veulent rester dans l’établissement, se félicite Gaëlle Griboval, directrice de l’Ehpad Denise-Delaby et responsable du comité de pilotage avec Éric Batecave. Pouvoir prodiguer des soins de qualité tout en se préservant, forcément cela redonne de l’attractivité à nos métiers ! » « Le soin de manutention s’inscrit dans les principes généraux de prévention, estime Clément Despierre, ingénieur-conseil à la Carsat Hauts-de-France. Évaluer le degré d’autonomie d’un résident, quelque part, c’est évaluer le risque. Quant à l’objectif de ne pas porter de charges délétères pour la santé, c’est tout simplement adapter le travail à l’homme. »
BON POUR LES AIDÉS !
Didier Deram, aide-soignant à l’Ehpad Denise-Delaby, accompagne Eugène pour l’amener de son fauteuil roulant au lavabo de sa chambre. « Allez, vous pouvez bouger votre pied… Voilà, penchez-vous en avant et tirez sur le guidon… Poussez sur vos jambes… » Ça y est, Eugène est debout, ravi. Il sourit à son reflet dans le miroir. « Redonner de l’autonomie, c’est une victoire. Nous avons accueilli il y a deux jours une dame qui était alitée depuis deux ans. Elle ne sortait plus et en souffrait. Nous avons fixé avec elle l’objectif de pouvoir l’amener dehors et, en la sollicitant, elle parvient déjà à s’asseoir dans son lit ! », s’enthousiasme Annick Nicolle, aide-soignante. « Les résidents prennent vite le coup, confirme Isabelle Fenzy, infirmière coordinatrice. Certains effectuent des mouvements d’eux-mêmes, comme croiser les jambes qui est la première étape pour se mettre sur le flanc dans leur lit lorsque les collègues leur disent qu’ils vont utiliser un drap de glisse, par exemple. »