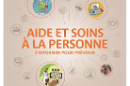« J’ai commencé ma carrière en tant qu’aide médico-psychologique et je n’ai pas toujours travaillé en prenant soin de moi. Je me suis fait mal et j’ai certainement déjà fait mal à des patients, estime Aurélie Landais, aujourd’hui conseillère en prévention des risques professionnels du centre hospitalier (CH) de Laval, en Mayenne. C’est ce constat qui m’a amenée à m’investir pour préserver la santé des soignants tout en cherchant à améliorer la prise en charge des personnes en perte d’autonomie. » Certifiée formatrice Prap 2S en 2016, la professionnelle s’initie à l’ALM en 2022 à l'occasion d'un stage qui visait à substituer la démarche ALM à l’approche gestes et postures dans le dispositif de formation à la prévention des troubles musculosquelettiques.
L’ALM, DES BASES SUR LESQUELLES ÊTRE CRÉATIF
L’ALM donne les principes pour mobiliser les patients grâce à leurs capacités résiduelles et n’utiliser qu’en dernier recours les aides à la manutention. Si la méthode ne donne pas de mode d’emploi pour chaque situation, elle offre toutes les clés afin de proposer un accompagnement à la mobilisation sans portage délétère, comme le montrent deux idées malines utilisées au CH Laval. En réanimation, les patients étant sédatés, il est possible de positionner, sans trop d’effort, un drap de glisse sous chaque moitié du buste en diminuant la pression du matelas à air qui équipe les lits du service. Puis, en le regonflant et en tirant sur les draps de glisse, la personne est rehaussée sans portage délétère. Et, en l’absence de potence de lit, il est possible de faire s’asseoir un patient qui a l’usage de ses bras en le faisant tirer sur des jerseys, textiles utilisés habituellement sous les plâtres, préalablement attachés aux pieds de lit.
« Au départ, je trouvais utopique l'idée de se baser sur les déplacements naturels que les patients étaient en capacité de réaliser. Mais j’ai vite été convaincue du fort potentiel d’amélioration des conditions de travail que ces compétences recélaient, confie Aurélie Landais. Pour être plus efficace dans sa mise en œuvre dans notre établissement -constitué d'un hôpital, de quatre Ehpad et d'un centre de santé mentale - qui compte 1 800 professionnels de soin, j’ai suivi début 2023 le stage pour devenir formatrice de formateur (Fo-Fo) sur le site nancéen de l’INRS. »
Dans la foulée, la préventrice met à contribution ses compétences récemment acquises. En plus de certifier 54 soignants acteurs ALM, elle permet cette année-là à six autres collègues d’accéder au titre de formateur. De quoi intensifier le rythme des stages pour accélérer la diffusion des nouveaux usages dans les différents services du CH Laval. En juillet dernier, en tout, 173 acteurs et onze formateurs étaient dépositaires de la démarche alors que cinq sessions supplémentaires devaient encore être menées au second semestre.
La révolution du zéro portage délétère
Ce déploiement va encore prendre de l’ampleur en 2026 avec 20 formations prévues. « Elles accueilleront chacune deux ou trois soignants en provenance d’autres établissements du département qui ont eu vent de cette dynamique, souligne Aurélie Landais. Même si nous donnons la priorité aux équipes du CH, nous sommes ravis d’accompagner ces structures dans leurs premiers pas de changement de culture. »

Cette révolution du zéro portage délétère pour la santé des soignants a déjà bien infusé dans l’hôpital lavallois, notamment dans le service de soins de suite, qui est celui qui compte le plus d’acteurs ALM avec 17 professionnels formés. Il a également été le premier à avoir son propre formateur, confirmant l’intérêt de disposer d’une telle ressource. Non seulement la dynamique de mise en œuvre y est particulièrement bonne, mais les chiffres de l’absentéisme et du turn-over y ont connu la baisse la plus importante de tout le centre hospitalier.
« On ne porte quasiment plus et cela nous préserve. Fini les douleurs en fin de journée », affirme Céline Leroi, aide-soignante et formatrice ALM du service. « En cas de situation particulière qui pose question sur la manière d’appliquer la démarche, nous échangeons avec Aurélie qui nous aide à faire émerger des propositions d’accompagnement », ajoute Maxime Fombertasse, un aide-soignant. Celui-ci doit justement compléter l’enseignement qu’il a reçu de l’ALM dans sa formation initiale avec une session dispensée en interne.
Stagiaires ambassadeurs
Avoir une Fo-Fo au sein du CH présente plusieurs avantages : cela augmente indéniablement la vitesse de déploiement de la nouvelle approche, mais également sa connaissance des équipes ainsi que des spécificités de l’établissement en termes d’organisation comme de dotation en matériel, permet d’adapter les sessions au terrain. La salle de formation, qui va bientôt être déménagée et dédoublée pour absorber l’augmentation du nombre de sessions, est dotée de lits et d’aides techniques à l’image de celles qui équipent l’établissement. Des outils moins recommandés, voire déconseillés, y sont également présents afin de mettre en lumière leurs défauts et de pouvoir expliquer pourquoi il est préférable de ne pas y avoir recours.
« La formation de formateur est dense et, surtout, pour obtenir le diplôme, il faut avoir satisfait l’ensemble des épreuves certificatives, dont font partie les travaux à réaliser en intersession, précise Aurélie Landais. Les stagiaires sont les ambassadeurs de cette nouvelle démarche. C’est une récompense de voir dans leurs yeux la prise de conscience, lorsqu’ils réalisent les améliorations que peut apporter l’ALM pour eux-mêmes et les patients/résidents. » Chargée également de piloter le réseau ALM au sein de l’établissement pour la direction des soins, elle se rend disponible pour toutes sollicitations, qu’il s’agisse de répondre aux interrogations des formateurs et des acteurs, de recueillir les demandes de matériels ou d’organiser des tests pour s’assurer de leur adéquation à la démarche.
Deux journées annuelles de séminaire permettent d’échanger autour de situations concrètes et de remontées de difficultés terrain qui nourrissent les cas étudiés pendant les formations. Quant aux quarts d’heure de sensibilisation dispensés dans leurs services par les formateurs, ils participent à la diffusion de la culture ALM en sensibilisant le personnel non encore formé. Si l’on en croit les résultats du suivi réalisé par le Copil Prap 2S qui met en lumière un ressenti amoindri des efforts physiques entre l’avant et l’après formation, la démarche devrait continuer à gagner du terrain et poursuivre son effet bénéfique sur les conditions de travail des soignants.
L'ALM, L'ESSAYER, C'EST L'ADOPTER

© Grégoire Maisonneuve pour l'INRS/2025
Lors des formations qu'elle dispense, Aurélie Landais, conseillère en prévention des risques professionnels du CH de Laval, a parfois à faire face à des réticences de professionnels qui ne connaissent pas la démarche ALM et viennent pleins d'a priori : « “Cette formation m’a été imposée, ça ne m’intéresse pas”, m’expliquait une stagiaire le premier jour de sa formation pour devenir actrice ALM, se remémore Aurélie Landais. À la fin de la semaine, je m’attendais au pire, mais elle avait totalement changé de discours et était convaincue. D’ailleurs, elle est aujourd’hui elle-même devenue formatrice. »