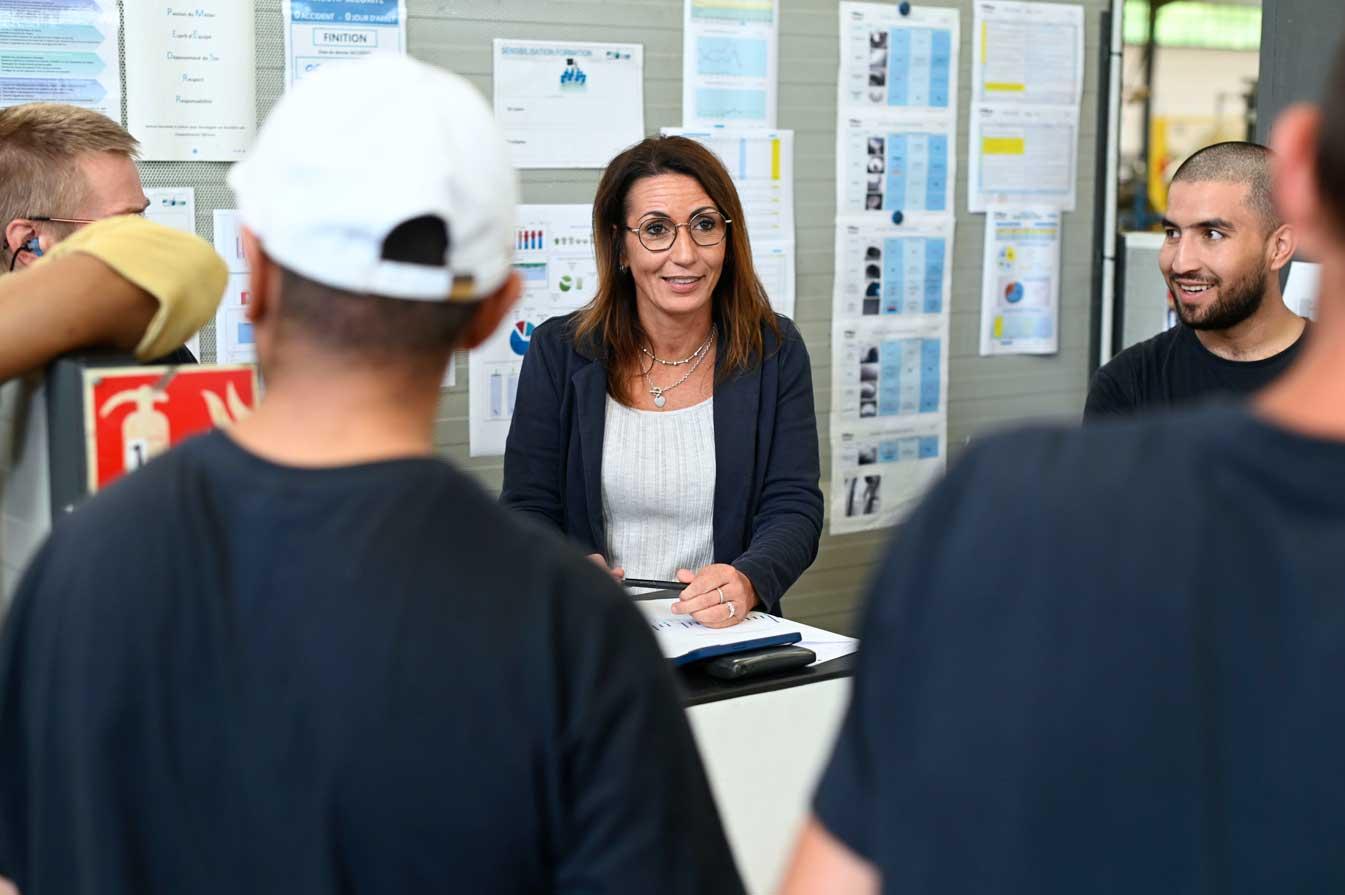Travail & Sécurité. Comment l’innovation peut-elle participer à l’amélioration des conditions de travail ?
Jean-Claude Sagot. Il faut avant tout qu’elle réponde aux attentes des utilisateurs, à leurs besoins ainsi qu’à ceux de l’activité, et qu’elle soit adaptée à leurs caractéristiques (âge, taille…). Le processus de conception classique comprend un ensemble d'étapes – analyse des besoins, études préliminaires, études détaillées… Ce qui est fondamental, c’est d’intégrer le facteur humain à toutes ces étapes et ce, avant même d’élaborer le cahier des charges.
Concrètement, qu’est-ce que cela signifie ?
J.-C. S. Si on prend pour exemple la conception d’un nouveau sécateur : un concepteur mécanicien étudiera les produits existants, puis il cherchera à innover en termes de matériau, de structure, de poids, afin d’améliorer ses performances techniques. Dans une conception centrée sur l'utilisateur, il s’agira d'abord d’analyser les sécateurs sur le marché, d’observer et d’évaluer comment les gens les utilisent (postures, gestes, efforts, préhension…), mais aussi de connaître toutes les conditions d’usage possibles, par exemple si les opérateurs s’en servent comme marteau, les transportent dans leurs poches… L’environnement de travail sera aussi analysé, ainsi que toutes les phases du cycle de vie du produit (maintenance, entretien). On va tenir compte de tous ces aspects et identifier tous les problèmes qu’ils peuvent poser en santé et sécurité pour l’opérateur (TMS, etc.). C’est à l'issue de ces évaluations que des recommandations pourront être faites, qui seront intégrées au cahier des charges et prises en compte aux étapes suivantes, lorsqu’il faudra définir de nouveaux concepts. Cela impose aussi d’effectuer des tests tout au long du processus, en conditions réalistes et réelles, pour toujours vérifier les conséquences des choix de conception sur la santé de l'opérateur.
Cette approche est-elle répandue ?
J.-C. S. Traditionnellement, on a de bons « observateurs » (psychologues, ergonomes…), capables d’analyser des personnes en situation de travail et de mettre en lumière des problèmes de stress, de contraintes physiques, etc., mais avec parfois des difficultés à transformer leurs évaluations en recommandations exploitables pour le concepteur ; de l’autre côté, nous avons aussi de bons ingénieurs, capables de concevoir des solutions innovantes, fiables techniquement, mais qui ne connaissent pas l’utilisateur. Ces deux mondes doivent travailler ensemble. Aujourd’hui, cela évolue, notamment dans le secteur automobile ou aéronautique : les services marketing, recherche & développement, bureaux d’études et production, qui étaient cloisonnés, travaillent désormais en ingénierie simultanée via des groupes de projet. Le changement passe aussi par la formation des ingénieurs. Les universités de technologie, de Compiègne, Troyes et Belfort-Montbéliard rapprochent les sciences pour l'ingénieur des sciences humaines. Elles recrutent des enseignants-chercheurs issus du monde du travail qui apportent leur savoir-faire aux étudiants. À l’UTBM, par exemple, nous avons créé une formation en mécanique et ergonomie, qui répond à ce besoin.
Globalement, que penser de l’apport des nouvelles technologies pour la santé et la sécurité au travail ?
J.-C. S. Robots, exosquelettes, IA… Souvent, les employeurs identifient des problèmes d’absentéisme, de TMS, et veulent des solutions clés en main, des produits sur étagères. Ils se tournent alors vers les nouvelles technologies. Mais là encore, il faut rester centré sur l’utilisateur. Beaucoup d’exosquelettes ont été rejetés par les opérateurs, car toutes les situations de travail n’avaient pas été prises en compte en amont. Et au lieu d’être une aide, le dispositif devenait une contrainte. Quant à l’IA, cela doit rester une base de données pour aider l’opérateur qui demeure aux commandes. Les technologies numériques offrent d’autre part des possibilités inédites, en conception. Grâce à la réalité virtuelle, il est possible d’immerger un opérateur dans une future ligne de production, afin d’observer et d’analyser ses comportements, d’anticiper les dysfonctionnements et de trouver des solutions adaptées. Pour autant, cela ne remplace pas les tests en conditions réelles. La réalité révèle des imprévus. Et malgré les avancées des systèmes haptiques, qui permettent de simuler un ressenti tactile ou des retours de force, il est encore impossible de réellement simuler le poids d’une charge.
REPÈRES
• 2007, création d’une formation d’ingénieurs en « mécanique et ergonomie » à l'UTBM, qui associe ergonomie, design et mécanique afin de concevoir des produits esthétiques, fonctionnels et adaptés aux utilisateurs.
• 100 étudiants sont diplômés chaque année.