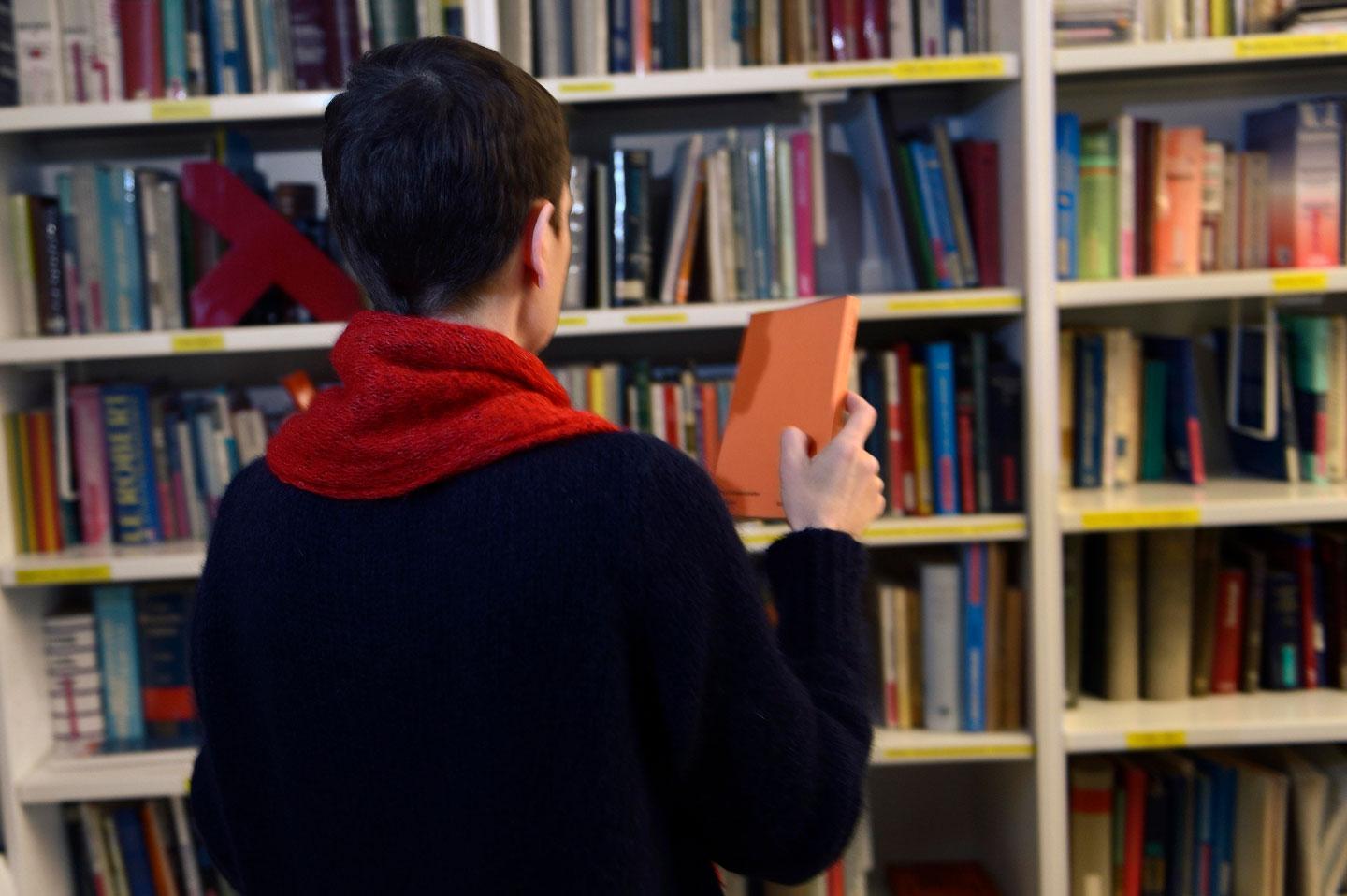Travail & Sécurité. Comment est né le syndicat des loisirs actifs (SLA) ?
Hélène Barbé. Il est lié à la création des parcours acrobatiques en hauteur (Ndlr : également appelés « Accrobranches »). En 1996, un chasseur alpin de Serre-Chevalier, dans les Hautes-Alpes, a eu l’idée d’installer, sur son terrain, quelques tyroliennes et des ponts de singe dans les arbres. C’est ainsi qu’est né le premier parc de ce type en France. Avec l’explosion de cette activité dans les années 2000, la profession a commencé à connaître des accidents et à réaliser qu’il était important de réglementer l’activité. D’où la création du syndicat des loisirs actifs pour disposer d’un organisme représentatif afin de siéger aux commissions de normes. Aujourd’hui, il y a plus de 650 parcs acrobatiques en France, dont 450 sont adhérents au SLA.
Quelles sont donc leurs obligations ?
H. B. Les normes EN 15667-1 et EN 15667-2 prévoient différents systèmes de sécurité passifs pour les clients, des lignes de vie continues, des mousquetons intelligents… En outre, un diplôme a été créé en 2006 pour devenir opérateur (surveillant), le CQP OPAH, Certificat de qualification professionnelle, opérateur de parcours acrobatiques en hauteur. C’était un souhait des exploitants qui, au départ, venaient, pour beaucoup d’entre eux, du monde de la montagne. La formation consiste en 24 heures d’enseignement théorique (techniques de corde…) réparties sur 3 ou 4 jours, puis 120 heures de stage de mise en situation professionnelle où ils apprennent la surveillance au sol, le briefing sécurité à donner aux clients, la gestion et le contrôle des équipements de protection individuelle (EPI)... Pendant ce stage, les apprenants sont toujours en binôme avec une personne expérimentée pour réaliser les manœuvres. Nous recevons des centaines de stagiaires par an. 99% choisissent également l’option « évacuation » pour apprendre les bonnes pratiques à adopter si une personne est bloquée en hauteur.
Comment agissez-vous pour la prévention des risques professionnels ?
H. B. Le syndicat réalise une veille des accidents du travail des exploitants. L’année dernière, nous avons enregistré trois accidents du travail dans la saison. Nous avons créé un cahier d’entraînement que nous avons envoyé à tous les parcs adhérents. L’idée est de proposer une grille d’exercices à réaliser à la prise de poste, en début de saison, car après six mois sans pratiquer, il est nécessaire de revoir certaines procédures. Ce document regroupe une trentaine de points à vérifier : les techniques de cordes sont-elles maîtrisées ? L’opérateur sait-il vérifier l’adaptation du baudrier à la morphologie d’un client ? Connaît-il la procédure d’évacuation qui nécessite des nœuds spécifiques ? Sait-il reconnaître un équipement de protection individuelle (EPI) abîmé (baudrier, mousqueton…) ? Le mettre au rebut si besoin ?
D’autre part, chaque année, au cours de notre assemblée générale, nous organisons une communication autour de l’accidentologie – avec un témoignage d’entreprise – et des conférences sur la prévention des risques professionnels. L’année dernière, nous nous sommes focalisés sur la gestion des flux, qui peut devenir compliquée avec la multiplication des visiteurs. Depuis la crise sanitaire, la fréquentation a augmenté de 20% et, lorsque les jours de beau temps sont peu nombreux, comme l’année dernière, tous les visiteurs se concentrent sur une courte période. On observe un peu plus de tensions qu’avant, mais c’est limité : d’abord parce qu’aujourd’hui, contrairement à l’avant-Covid, deux-tiers des parcs proposent la réservation en ligne, ce qui permet d’anticiper les flux et de limiter les mécontentements. Nous sommes aussi limités par le nombre de baudriers : lorsque celui-ci est atteint, nous fermons la billetterie. C’est très clair et très bien compris par le public.
Quels sont les autres risques auxquels peuvent être exposés les salariés ?
H. B. Les risques principaux sont évidemment les chutes mais aussi les malaises, dus à des coups de chaleur, notamment. L’une de nos spécificités est le travail en extérieur donc les opérateurs sont soumis aux variations de température. D’autant qu’en plus des parcs de parcours acrobatiques en hauteur, nous comptons dans nos adhérents des exploitants de parcs aquatiques gonflables. Nous envoyons une newsletter tous les 15 jours dans laquelle nous les sensibilisons sur ce sujet en rappelant les mesures à mettre en œuvre en cas de travail à la chaleur : pauses régulières, installation de fontaines d’eau…
Plus globalement, nous proposons différentes formations, dont une dédiée au document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) en petits groupes. D’autre part, ces structures sont soumises à un contrôle technique et phytosanitaire chaque année. À cette occasion, nous essayons, avec les contrôleurs, de les sensibiliser à l’analyse de risque, à l’arbre des causes… Ces dernières années, il y a eu beaucoup de progrès concernant la réalisation du DUERP chez nos adhérents, mais il faut poursuivre les efforts.